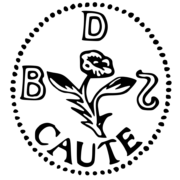Une fuite en avant irresponsable
Texte publié dans Le Figaro du 27 juillet 2020.
Pourquoi une telle accélération ? Au lendemain d’une épidémie mondiale, à la veille d’une crise économique inouïe, l’Assemblée nationale se réunit en session extraordinaire. Un texte examiné en priorité : l’ouverture de la « PMA pour toutes »… Il y a des urgences qui trahissent des obsessions idéologiques plutôt qu’elles ne répondent aux besoins vitaux de la société. Ce n’est, il est vrai, pas nouveau : depuis l’annonce de cette mesure en septembre 2017, le gouvernement aura mis beaucoup d’énergie pour dissimuler, à défaut de pouvoir les résoudre, les nombreux problèmes causés par cette réforme. Agnès Buzyn consacrait ses efforts à la question de savoir « si un homme à l’état civil pourrait devenir mère », ou comment l’Assurance maladie pourrait rembourser une prestation en l’absence de toute maladie. Pendant ce temps, l’hôpital public traversait une crise majeure, le même gouvernement déremboursait des médicaments traitant la maladie d’Alzheimer, et personne ne s’occupait du fait que nos derniers stocks stratégiques de masques étaient en train de pourrir, grignotés par des rongeurs. Quelques semaines plus tard, les infirmières allaient être contraintes de se bricoler des blouses de protection avec des sacs poubelles ; c’est qu’au moment où la pandémie explosait en Chine, notre Ministre de la santé était trop occupée à l’Assemblée pour démêler les noeuds inextricables que sa propre réforme causait. Des difficultés susceptibles de fragiliser toute l’architecture de notre droit de la santé et de la famille… Rappelons en effet que cette mesure, au bénéfice de quelques centaines de personnes par an, représente selon le dernier avis pourtant favorable du CCNE “le risque d’une déstabilisation de tout le système bioéthique français.”
Il y a seulement trois ans, le même CCNE décrivait comme un « point de butée » le fait de « ne pas s’engager dans un processus qui organiserait l’absence de père, ou considérer (…) que l’on ignore encore aujourd’hui comment les sujets concernés vont se construire dans ces nouvelles situations ». Mais que voulez-vous, au nom du désir de l’adulte, un point de butée, ça s’efface. Les députés de la majorité ont donc, au coeur de l’été, dans l’indifférence générale, supprimé ces mots de la loi : « Nul n’a le droit à l’enfant ». Vous souvenez-vous encore de ceux qui juraient, il y a quelques semaines encore, que jamais il n’y aurait de “droit à l’enfant”? Eh bien c’est fait : maintenant vous y avez droit, et la technique sera sommée de vous le fournir si vous ne voulez pas d’un père – demain, pourquoi faire semblant de le nier, la mère deviendra à son tour superflue, aucune raison qu’elle échappe à l’égalité en marche.
Car c’est au nom de l’égalité qu’on a martelé ce sophisme : si la PMA est ouverte aux couples hétérosexuels, elle doit l’être aussi aux couples homosexuels. Il faut le redire encore : la procréation n’était assistée par la médecine que parce qu’une infertilité biologique empêchait un couple hétérosexuel d’avoir un enfant. Désormais, on demande à la médecine d’intervenir hors de toute pathologie, non pour rétablir l’équilibre ordinaire des corps, mais pour s’en affranchir. Point de départ d’une logique qui ne peut que nous conduire à repousser bien d’autres « points de butée », au nom de l’alliance toute-puissante du désir et de la technique contre les limites naturelles de nos corps, et les frustrations qu’elles nous causent. Alors que le Premier ministre nous veut « tous écologistes ! », l’histoire retiendra que son gouvernement aura commencé par cette terrible contradiction…
« Tous écologistes », vraiment ? Au lendemain d’une pandémie révélant le danger des maladies transmissibles entre espèces, la loi autorise la création d’embryons transgéniques ou chimériques, mêlant des cellules souches humaines et animales. Elle assouplit les règles de recherche sur l’embryon humain, qui devient un matériau de laboratoire comme un autre. Elle ouvre la voie à la levée de l’anonymat du don de gamète, déstabilisant dans son principe tout le modèle français en matière de don d’organes. Le gouvernement, trop occupé par le remaniement, ayant déserté la commission spéciale, les députés de la majorité se sont affranchis des dernières précautions qu’ils s’étaient eux-mêmes imposés en première lecture, avec une légèreté sidérante. Ils ont rétabli le remboursement de la PMA par l’assurance-maladie : le CCNE avait pourtant conditionné son avis favorable à l’interdiction de ce remboursement… Ils ont supprimé les mesures proposées par le Sénat pour contrer les fraudes en cas de GPA à l’étranger ; ils ont même adopté une technique apparentée, dite de la ROPA, qui permet à une femme de porter l’ovocyte d’une autre.
Plus terrible encore : ils ont élargi la possibilité du tri sur les embryons via un DPI étendu aux maladies chromosomiques. Derrière l’abstraction de ces termes techniques, il y a un projet simple, demandé par le député Philippe Vigier il y a quelques semaines à la tribune de l’Assemblée : « Il faut traquer, je dis bien traquer, les embryons porteurs d’anomalie ». Agnès Buzyn elle-même s’y était opposée, dénonçant une « dérive eugénique claire » ; et plusieurs députés LREM, concernés comme parents ou comme soignants par le handicap, avaient exprimé leur désarroi devant cette revendication. Quelle société sommes-nous en train de construire ? C’est tout notre rapport à nos corps, à la technique médicale, et à la condition humaine elle-même, qui est sur le point de changer. Pour tous… Tous éligibles au droit à l’enfant, produit sur commande, sélectionné et financé. Ou tous liés par une condition humaine imparfaite, tous porteurs d’anomalies et de défauts plus ou moins visibles, mais capables pourtant de reconnaître la valeur infinie de toute vie, et d’en prendre soin telle qu’elle est – tous écologistes, vraiment !
Alors que les Français sont légitimement préoccupés par les nouvelles du front sanitaire et économique, leurs représentants s’apprêtent à voter en leur nom l’entrée dans un autre monde – celui qui remplacera à terme, de l’aveu même du rapporteur de cette loi, l’engendrement naturel de l’enfant par la procréation technique et sa sélection organisée. Bien sûr, il est confortable de se laisser endormir par la fable du progrès souriant face à l’obscurantisme ronchon ; mais il n’est personne d’un peu sérieux qui ait suivi ces débats et qui ne mesure, quelle que soit la position, l’ampleur de ce qui est en jeu. Le CCNE reconnaît des « changements anthropologiques majeurs ». Le simple respect de la démocratie supposerait de laisser le débat reprendre normalement en septembre, pour permettre au moins aux Français de savoir ce que leurs élus veulent faire des voix qu’ils leur ont confiées.
Interrogé à ce sujet dans la matinale de RTL le jeudi 30 juillet 2020 :