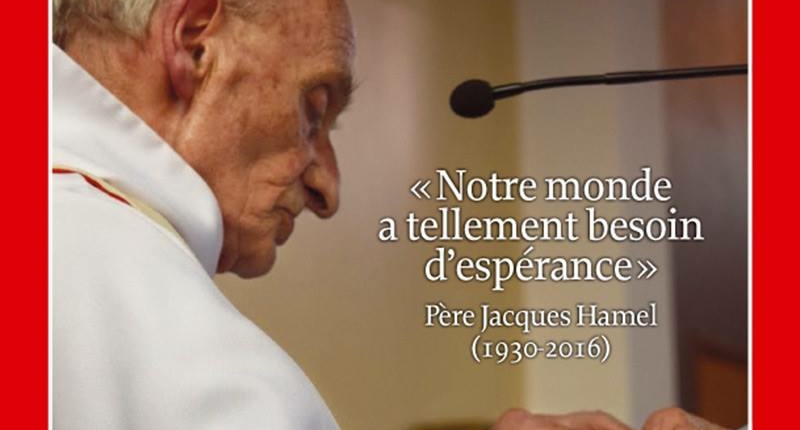Tout est à reconstruire. Tout commence.
Texte paru dans le Figaro du 27 avril 2017.
Cette élection présidentielle laissera à des millions de Français le sentiment amer d’un rendez-vous manqué ; et cet échec est lourd de conséquences. Alors que notre pays, pourtant riche d’un potentiel exceptionnel, traverse une crise qui touche aujourd’hui toutes les dimensions de notre vie collective, il était plus nécessaire que jamais d’aboutir à un choix clair, assumé, et rendu légitime par un vrai débat de fond. C’est ce cap cohérent qui a tant manqué à la France depuis cinq ans. Pouvions-nous nous offrir le luxe d’un nouveau choix grevé d’ambiguïtés ? C’est pourtant ce qui vient d’arriver. Emmanuel Macron va emporter cette élection présidentielle en ayant essayé jusqu’à un mois avant le vote de ne pas présenter de projet, remplaçant l’exigence démocratique de clarté et de transparence par une stratégie marketing qui disait tout et son contraire à toutes les clientèles possibles : la France est coupable de crimes contre l’humanité, mais en même temps ils ont eu des aspects positifs ; M. Saou est un islamiste radical, mais en même temps c’est quelqu’un de très bien ; il faut promouvoir la culture française, mais en même temps elle n’existe pas ; il faut plus de protection sociale, mais en même temps moins de charges… A quelques jours du premier tour, dans une triste comédie, les partisans de M. Macron scandaient ce « en même temps », devenu symbole des séductions contradictoires par lesquelles ils avaient été attirés, et que notre pays va maintenant payer au prix fort par la colère et la frustration qu’elles ne manqueront pas de susciter à l’inévitable épreuve du réel.
A rebours de ces calculs, la droite avait vécu une expérience forte de clarification politique, à travers une primaire dont le débat avait suscité une très large participation. Elle était prête à contribuer à cette élection présidentielle en proposant un projet approfondi, explicite, courageux, et légitimé par des millions de Français. On connaît la suite : il est apparu que François Fillon n’avait pas été fidèle à l’idée qui l’avait fait sortir vainqueur de cette primaire, et il s’en est suivi un emballement médiatique qui a dépassé de très loin le devoir d’information. Dans cette affaire, la première victime n’a pas été la droite, mais la France : il aurait fallu parler d’emploi, d’éducation, de famille, de culture, d’innovation, de fiscalité, de sécurité, de défense… et nous avons finalement débattu pendant deux mois de costumes et d’assistants parlementaires. Aujourd’hui, une campagne défectueuse accouche d’un choix par défaut. Un de plus. Un de trop.
Maintenant, la responsabilité qui pèse sur la droite est immense : délivrée des affaires qui pesaient sur son candidat, elle doit porter avec force son projet pour les élections législatives, dont l’enjeu sera décisif. Il faut rassembler une majorité de Français autour de ce projet, face à M. Macron, afin d’éviter que se réalisent les dérives graves sur lesquelles nous n’avons cessé, à raison, de lancer l’alerte tout au long de ces derniers mois. Ne pas reprendre le flambeau, ce serait de toute évidence laisser M. Macron installer le scénario dont il rêve, celui d’un duo pour dix ans avec Marine Le Pen dans le rôle de seule opposante. C’est tout le sens du rouleau compresseur moralisant par lequel ses soutiens exigent que tout responsable public fasse séance tenante allégeance à leur candidat, au motif qu’en dépendrait un second tour qu’ils ont pourtant déjà célébré comme un succès gagné d’avance… Cette stratégie d’intimidation est un scénario bien rôdé ; mais elle constitue un grand risque pour l’avenir de notre débat politique, alors que la peur qu’on nous mime ne se fonde sur aucun élément raisonnable.
Car cette élection nous livre un dernier enseignement. Mme Le Pen ne gagnera pas ce second tour : jamais, même à l’issue d’un premier tour aux régionales qui lui était bien plus favorable, elle n’a suscité autour d’elle une majorité ; et ce ne sont pas les contradictions tout aussi inquiétantes de ses lieutenants, qui lançaient lundi matin un appel pathétique aux soutiens de Nuit Debout, qui pourront la réunir. Le Front National apparaît donc pour ce qu’il est : une formidable machine à empêcher le renouveau, et à maintenir en fonction les tenants de la déconstruction. Mme Le Pen avait fait élire François Hollande en 2012, et elle s’apprête à rééditer l’exploit : il aura fallu tout son poids pour réussir aujourd’hui cette incroyable prouesse, que le premier président à avoir été assez impopulaire pour ne même pas oser se représenter soit pourtant remplacé par celui qu’il voit comme son « fils », son double et son héritier.
La situation est donc claire : au terme d’une campagne qui n’aurait hélas pas pu lui être plus propice, il est désormais certain que le Front National ne sera jamais qu’une impasse pour les électeurs qui se tournent vers lui. Il les condamne ainsi au désespoir politique. Si nous ne voulons pas que demain toutes les colères de la France ne finissent par déborder avec violence la voie de nos institutions, il nous faut reconstruire une proposition qui puisse parler à tous ceux que les transformations du monde laissent aujourd’hui au bord du chemin. Ce n’est pas l’injonction morale qui nous sortira de ce piège, c’est le travail politique, quand il fera l’humble effort de se remettre au service de tous, et notamment des plus fragiles parmi nous. Nous devons porter le projet d’une société qui saura d’autant mieux aborder les opportunités nouvelles qu’elle aura su reconstruire les permanences qui la fondent – la famille, l’école, une culture ancrée dans la fécondité d’un héritage, un modèle politique solide qui garantit nos libertés – toutes ces stabilités que la société liquide du progressisme naïf continuera de fragiliser, au détriment des plus vulnérables. M. Macron est le candidat de ce qui marche sans savoir où, nous devons défendre ce qui demeure et qui nous relie – parce que cela seul peut donner à la France une raison de s’engager dans l’avenir avec confiance et liberté. Si nous n’y parvenons pas, notre débat politique sera durablement paralysé, incapable d’offrir un vrai choix démocratique, et la défiance qu’il suscite ne cessera de s’aggraver. Le travail qui nous attend est immense. Tout est à reconstruire. Tout commence.
.

 A quelques jours du premier tour, long débat avec Jean-Louis Bourlanges, l’un des grands soutiens d’Emmanuel Macron, dans les colonnes du Point. Texte complet à retrouver sur six pages dans l’édition du magazine datée du 20 avril 2017.
A quelques jours du premier tour, long débat avec Jean-Louis Bourlanges, l’un des grands soutiens d’Emmanuel Macron, dans les colonnes du Point. Texte complet à retrouver sur six pages dans l’édition du magazine datée du 20 avril 2017.