
Entretien initialement paru dans la revue Valeurs Actuelles du 9 novembre 2023. Photo : Jean-Baptiste Delerue / PHILIA
Quelle serait aujourd’hui notre raison d’espérer ?
Il faut regarder l’espérance pour ce qu’elle est : un acte de la volonté qui ne se cherche pas d’abord des raisons de se rassurer, mais qui s’impose de se battre comme si une chance existait, même quand toute la réalité semble nous dire qu’il n’y en a plus. Là réside la radicalité de l’espérance. Le courage de l’espérance, d’une certaine façon, c’est le courage désespéré. Comme le dit Bernanos, pour connaître l’espérance, il faut non pas avoir des raisons d’être optimiste, mais au contraire, avoir été au bout du désespoir. Et, ayant affronté le désespoir, se dire que si jamais il existe un chemin, si jamais il y a une chance que tout ce à quoi nous tenons et qui semble disparaître se relève et se ranime, cette seule chance même improbable vaut la peine qu’on engage notre vie entière pour pouvoir la rendre possible.
De quoi les évènements récents sont-ils le nom ?
Du retour du tragique de l’histoire. Derrière l’Arménie aux prises avec l’Azerbaïdjan, ou Israël attaqué par le Hamas, se découvre, en réalité, le même visage, même si chacun de ces conflits est singulier. Mais ce qui me frappe le plus, c’est, face à ce retour du tragique, le sentiment que nous n’avons plus la main, que nous n’avons plus la capacité d’agir et de décider du destin de notre monde et du nôtre.
C’est ce que vivent particulièrement tous ceux qui servent l’État, et qui sont concrètement confrontés à l’impuissance publique. Je pense aux policiers entendant le président de la République dire qu’on n’empêchera jamais le terrorisme. Je pense aux professeurs qui savent très bien que personne ne les protègera quand le premier fou furieux aura décidé de les sacrifier. Je pense aux infirmières qui voient l’hôpital s’effondrer autour d’elles sans pouvoir rien y faire. Tous ceux qui devraient être le bras de la force publique sont aujourd’hui les spectateurs désolés de son impuissance.
De quoi souffre l’Occident dont ne souffrent pas les autres parties du monde ?
De quoi sommes-nous le nom ? Quelle est notre mission dans l’histoire ? Quelle est notre vocation ? Aujourd’hui, il est plus simple pour un Chinois, pour un Saoudien, et même d’une certaine manière pour un Américain, de savoir quelle est la place que chacun occupe dans l’histoire, et le rôle qu’il faut y jouer. Nous, nous avons décidé avec beaucoup de détermination de déconstruire ce qui peut faire le sens même de l’existence de la civilisation que nous recevons en partage. Sur France Info, j’ai entendu un élève de Dominique Bernard témoigner sur le professeur qu’il était : « Il parlait comme un professeur de français en utilisant des mots que personne ne comprend ». Et il prenait pour exemple « aparté », qui lui paraissait un étrange reliquat obsolète d’une langue déjà disparue. La mort de Dominique Bernard est le symptôme de la faillite de l’école. On a laissé derrière nous des jeunes assez décérébrés pour adhérer à l’islamisme qui prospère aujourd’hui sur TikTok et dans les quartiers. Dans sa lettre à un djihadiste, Philippe Muray écrit : « Chevauchant vos éléphants de fer et de feu, vous êtes entrés avec fureur dans notre magasin de porcelaine. Mais c’est un magasin de porcelaine dont les propriétaires, de longue date, ont entrepris de réduire en miettes tout ce qui s’y trouvait entassé. (…) Vous êtes les premiers démolisseurs à s’attaquer à des destructeurs. »
Comment lutter contre cette « décivilisation » ?
La seule et l’unique et l’essentielle urgence pour l’avenir du pays, c’est l’école. Ce qui compte, c’est d’éduquer. Ce qui compte, c’est de professer. Ce qui compte, c’est d’avoir des professeurs. Et il y a urgence, car il s’agit sans doute du seul sujet sur lequel on puisse faire des erreurs irréversibles. Si demain on décidait de remettre un peu de sécurité, d’autorité, il y aurait des résistances, mais on saurait remettre des policiers dans la rue. Si on voulait retrouver un peu de rationalité budgétaire, ce serait difficile, mais on pourrait rétablir nos comptes publics. Tout cela peut se réparer. Mais quand on a cessé de transmettre pendant vingt, trente ou quarante ans, qui demain pourra enseigner le savoir qui n’a pas été transmis ?
Qu’est-ce qu’une bonne école alors ?
Une bonne école, c’est une école qui sait avoir pour seule et unique mission de transmettre – le savoir, la culture, la connaissance. Bien sûr, il faut se garder de toute idéalisation : l’expérience de la pédagogie n’est jamais une évidence ; elle suppose d’affronter la difficulté de la relation humaine que représente toujours le travail éducatif. Comme le disait Alain, la pédagogie est la science des professeurs chahutés. Il n’y a jamais de miracle. Mais le vrai problème aujourd’hui n’est pas la difficulté d’éduquer, ou qu’on n’y parvienne plus ; le problème, c’est qu’on ne veut plus éduquer, que les enseignants se sont vus privés de leur mission. Péguy expliquait déjà en 1907, dans Pour la rentrée, ce qui vaut pour toute situation semblable : « La crise de l’enseignement n’est pas une crise de l’enseignement ; il n’y a jamais eu de crise de l’enseignement ; les crises de l’enseignement sont des crises de vie. […] Quand une société ne peut pas enseigner, ce n’est point qu’elle manque accidentellement d’un appareil ou d’une industrie ; c’est que cette société ne peut pas s’enseigner ; c’est qu’elle a honte, c’est qu’elle a peur de s’enseigner elle-même. »
La seule et l’unique et l’essentielle urgence pour l’avenir du pays, c’est l’école. Ce qui compte, c’est d’éduquer. Ce qui compte, c’est de professer. Ce qui compte, c’est d’avoir des professeurs. Et il y a urgence, car il s’agit sans doute du seul sujet sur lequel on puisse faire des erreurs irréversibles.
Comment jugez-vous les premiers pas de Gabriel Attal ?
Interdire l’abaya ? C’était élémentaire. Je ne dis pas que ce n’était pas courageux, mais c’était la moindre des choses. Maintenant, le premier problème de l’école en France, ce n’est pas l’abaya. Il y a des gamins qui ont passé quinze ans sur les bancs de nos classes et qui finissent en brûlant des écoles. Voilà ce qui s’est passé lors des émeutes de juin dernier.
Un jeune français sur cinq, à 18 ans, ne sait pas lire le français. Nos élèves sont les derniers d’Europe en mathématiques. Nous avons le système scolaire le plus inégalitaire de tout l’OCDE. Est-ce que Gabriel Attal va changer cela ? S’il le fait, j’applaudirai des deux mains. Mais en attendant, comme professeur, il y a quelque chose qui me heurte dans sa nomination : qu’on puisse confier l’Education nationale, le sujet le plus décisif pour l’avenir du pays, à quelqu’un qui a priori n’en connaît rien, qui n’a jamais touché à l’enseignement de près ou de loin. Parce que Gabriel Attal avait envie de ce poste pour exister politiquement, dans un remaniement qui semble avoir été presque improvisé, on lui attribue en dernière minute le ministère le plus complexe et le plus essentiel – 1,2 millions de fonctionnaires, le premier budget de l’État, l’avenir du pays. Il y a là une désinvolture assez improbable.
Parmi les causes de l’assassinat de Dominique Bernard, vous citiez dans le Figaro, l’immigration incontrôlée. Mais pourquoi n’arrive-t-on pas à la contrôler ? N’est-ce pas parce que nous avons perdu le sens de ce qu’est une cité politique, le bien commun, et le rôle d’un État qui est là pour servir un peuple et une histoire donnés ?
La vie civique commence par la reconnaissance du caractère structurant du sentiment d’appartenance à une communauté politique. Même en cochant les cases de la bonne volonté, tous les gens qui aiment la France n’ont pas pour autant un droit opposable à notre nationalité ; c’est donc a fortiori encore plus vrai de ceux qui ne l’aiment pas. Au fond, la crise de l’école et la crise migratoire n’en sont qu’une : elles sont le révélateur d’un même vide intérieur. Parce que nous ne savons plus qui nous sommes, ni ce que signifie d’être une cité, parce que nous avons oublié que la culture est l’essentiel, nous avons sombré à la fois dans l’effondrement de l’école et dans l’immigration massive. Ces deux faillites procèdent de la même vision anthropologique. Qu’est-ce qui justifie aujourd’hui que Gérald Darmanin propose la régularisation des clandestins dans les métiers en tension ? C’est une vision de l’homme fondée sur sa réduction à l’homo oeconomicus, à l’animal laborans, à l’individu au rôle de rouage utile pour la machine économique, où tout ne serait qu’affaire de calcul. Dans cette perspective, le territoire d’un pays n’est plus en effet qu’un espace géométrique neutre dans lequel des atomes indifférenciés se déplacent comme des particules élémentaires…
Que faire de nos ennemis de l’intérieur, présents sur notre sol en nombre conséquent ?
Il y a, d’une part, la question des étrangers. Pour compliquée qu’elle soit, elle n’a rien d’insoluble. Il est stupéfiant de voir, trois jours après la mort de Dominique Bernard, le président de la République et le ministre de l’Intérieur se réveiller et proclamer soudain : « Il faut expulser avec fermeté les étrangers dangereux ». Pourquoi ne pas l’avoir fait avant ?
La question beaucoup plus difficile concerne ceux qui sont Français et qui participent pourtant à la menace islamiste. Il est impératif d’avoir enfin une vraie stratégie, dans deux directions simultanées. D’abord pour le contre-terrorisme : il serait révoltant de céder à la démission en disant, comme le président de la République il y a quelques jours, que le terrorisme ne peut pas être éradiqué. Ne pas se résigner, c’est se donner les moyens de mener dans la durée un travail déterminé pour améliorer notre capacité de renseignement et de protection. Nous sommes bien sûr capables de mener et de remporter ce combat contre le terrorisme islamiste, d’autant plus que nous parlons ici d’adversaires médiocres, dont les capacités sont rudimentaires. Et la seconde direction, c’est le travail qu’il faut mener pour gagner la bataille idéologique, pour gagner la bataille des cœurs.
Avec quels outils ?
La France n’est pas aimée, alors qu’elle a tout pour l’être. Ce n’est pas très difficile de susciter la passion de la France. Dans l’Education nationale, il suffit qu’on décide de transmettre à nouveau ce que nous avons à offrir, et nous trouverons de nouveau l’enthousiasme pour l’accueillir. Comme beaucoup de collègues, je peux témoigner de cela, sans aucune facilité. Souvenez-vous de l’instituteur de Camus, Monsieur Germain, qui faisait des Français dans son faubourg d’Alger avec ces gamins venus des quartiers les plus pauvres. Le miracle est toujours disponible. Ce sont des adultes, non des enfants, qui ont organisé la rupture de la transmission. Ce ne sont pas nos élèves, même issus de l’immigration, qui ont dit que la France était coupable de crime contre l’humanité. Ce ne sont pas non plus nos élèves qui ont dit qu’il n’y avait pas de culture française. C’est Emmanuel Macron qui a dit cela – et ses propos n’étaient que le symptôme d’une crise collective.
Au-delà de la reconstruction de l’école, nous devons donc retrouver une stratégie pour la bataille culturelle. Sur les réseaux sociaux, il faut apporter un contre-discours, développer notre narratif. Qu’est-ce que la France fait pour que sur TikTok, on aille combattre les discours qui salissent le pays ? Comment y participe notre production audiovisuelle, nos séries ? Aujourd’hui, c’est Netflix qui invente les représentations du monde ; que faisons-nous pour ne pas laisser le monopole de l’imaginaire à une industrie américaine obsédée par la déconstruction de notre héritage ? Cela peut paraître dérisoire, mais je me suis battu au Parlement européen pour interdire les télécommandes qui renvoyaient directement à Netflix, et j’ai obtenu cette interdiction. Rien n’est anecdotique quand il s’agit de sortir du circuit fermé que cette production culturelle voudrait nous imposer. Mais il nous faut maintenant construire une alternative.
Comment sortir du paradoxe d’un état de droit qui nous enchaîne plutôt qu’il ne nous protège ?
En réalité, aujourd’hui, ce que beaucoup appellent l’état de droit est devenu l’état de non-droit. Reprenez le cas de la famille Mogouchkov. Déboutés deux fois du droit d’asile, ils sont toujours sur le sol français parce qu’une obscure circulaire empêche leur expulsion. Le débat sur l’état de droit opposait habituellement la loi à la puissance publique, montrait les tensions possibles entre le droit et la démocratie, entre le droit et l’État. Mais aujourd’hui, il me semble qu’il y a un combat entre le droit et le droit. La lettre et l’esprit de la loi sont désactivés par une montagne de complexité réglementaire et administrative ; la jurisprudence annule les principes fondamentaux du droit. Je ne suis pas pour l’Etat contre le droit ; je suis pour que force revienne enfin à la loi.
Pour retrouver l’état de droit, encore faut-il que les juges acceptent que la loi doit s’imposer. Le fait que le Syndicat de la magistrature organise une rencontre à la Fête de l’Huma sur les « violences policières », ou participe à des manifestations d’extrême gauche contre la police, devrait être pour nous un sujet majeur. Ce syndicat, qui représente un tiers des magistrats, a fondé sa philosophie sur la harangue de Baudot, qui intime aux juges de ne pas être neutres : « La loi dira ce que vous voulez qu’elle dise. Soyez partiaux, pour le voleur contre la police, pour le plaideur contre la justice ».
En introduction de votre livre, vous avez un passage très éclairant sur le pardon, la liberté qu’il confère. Est-ce qu’on ne pourrait pas expliquer en partie le wokisme par l’oubli de cette belle vertu du pardon, parc que le wokisme, c’est considérer le passé de l’Occident comme un crime inexpiable : pour l’Occident, la seule manière de l’expier serait de disparaître, en l’absence de pardon.
Les gens qui se revendiquent le plus du wokisme sont ceux qui auraient le moins de raison d’exiger un pardon quelconque. On n’a jamais été aussi peu victimes et on ne s’est jamais autant sentis en permanence persécutés ; c’est quand même fascinant. Ce sont des gamins qui ont tout reçu, qui ont grandi dans la génération la plus gâtée de l’histoire, et qui se sentent victimes de tout.
Mais ils se sentent victimes aussi par procuration, c’est-à-dire que le bourgeois du XVIᵉ demande à l’Occident d’expier l’esclavage des Noirs aux États-Unis.
Mais ce n’est pas tellement lui qui aurait des raisons d’exiger un pardon, c’est le paradoxe de l’histoire. Ce qui est sûr, c’est que le pardon est un scandale. Comme l’espérance d’ailleurs, le pardon est lui aussi un scandale pour la raison. Il n’y a de pardon que pour ce qui est impardonnable, comme l’espérance n’a son lieu que là où il n’y a pas de raison d’espérer. Si on pardonne ce qui a des raisons d’être pardonné, alors on pardonne ce qui est excusable, et du coup ce n’est pas un pardon. Si j’arrive en retard et que j’ai une bonne excuse, parce que mon train a été annulé par exemple, vous ne faites pas un grand acte de générosité en excusant ce qui est excusable. Mais quand on voit le visage du mal dans les crimes commis contre des Israéliens le 7 octobre, contre des civils, des femmes, des enfants, on ne peut que se demander : « Mais comment un pardon est possible pour cela ? ». C’est là, devant l’inexcusable absolu, que le pardon est évidemment un scandale ; mais c’est sans doute là qu’on peut le mieux voir ce qu’il constitue.
Sur le wokisme, comment expliquez-vous que cette idéologie assez récente et assez minoritaire ait réussi à structurer le débat public à ce point ? Et comment est-ce qu’on en sort ?
Un tel discours n’est possible que sur l’effondrement de la raison. Mais le wokisme a-t-il réellement triomphé aujourd’hui dans le paysage français ? Si dans notre pays la culture commune, la transmission à l’école, l’autorité de l’État, la protection de nos principes les plus fondamentaux, si tout ça n’était menacé que par des gens qui sont vraiment wokistes, honnêtement, tout irait très bien. Jean-Michel Blanquer n’était pas du tout woke, mais il a fait la réforme du bac.
Justement, dans le contexte de la faillite de l’école, est-ce que Netflix n’a pas beaucoup plus de pouvoir sur la structuration des jeunes esprits que l’Éducation nationale ?
Les écrans ont pris le pouvoir, mais ceux qui ont donné le pouvoir aux écrans, y compris dans l’école, ne sont pas eux-mêmes “wokistes”, au sens habituel du terme. Et si, au contraire, l’école assumait d’être ce qu’elle doit être, c’est-à-dire si un ministre de l’Éducation nationale arrivait demain en disant : « À l’école, ce qui doit régner, ce n’est pas l’écran, c’est le livre ; donc plus d’écran, plus de téléphone dans l’école. Notre travail à nous, c’est de vous apprendre à grandir sans écran. Et non seulement on va bannir les écrans des écoles, mais on va travailler avec les parents pour arrêter cette folie qui consiste à mettre un iPhone dans les mains d’un gamin de dix ans. » Si on faisait ce travail-là, on ferait reculer les vecteurs du wokisme. Les gens qui lui offrent tout cet espace, toute cette place, les dirigeants qui ont fini par fragiliser en profondeur le travail de la transmission, n’étaient pas eux- mêmes wokistes. Il y a une forme de lâcheté, de déni, d’abandon, parfois de cynisme, de complaisance avec la déconstruction, qui ne vient pas directement de ce courant de pensée. Le problème, c’est cette haine de soi dont le wokisme n’est qu’une manifestation singulière. L’école a été détruite de l’intérieur, pas depuis que le wokisme existe, mais depuis maintenant des décennies. Le wokisme est une forme d’accouchement monstrueux de la déconstruction qui dure depuis bien longtemps.
Dans votre livre, vous expliquez qu’aujourd’hui, les gens n’arrivent plus à comprendre que la violence fait partie de l’existence. Et, paradoxe, cette violence, pour autant, elle est partout, y compris dans la vie politique qui est de plus en plus hystérisée. Comment lutter justement contre cette hystérisation de la vie politique ?
Je crois qu’il y a une manière de pratiquer l’exercice politique qui correspond à cet objectif. Si on s’inquiète de la décivilisation, de l’ensauvagement, alors il faut peut-être commencer par s’imposer à soi-même une exigence de civilité. Ce n’est pas seulement dans le discours, mais aussi dans la méthode qu’on doit être à la hauteur de ce qu’on prétend avoir à défendre. Cela ne veut pas dire qu’il faille oublier la violence à laquelle la politique sera toujours confrontée. Il est nécessaire de sortir du déni constant aujourd’hui sur ce sujet : juste après l’attentat d’Arras, Brigitte Macron promet « des cours de bienveillance »… Et le président remercie tout le monde, les policiers, les pompiers, les soignants, le chauffeur de l’ambulance, comme si on était à une cérémonie des Césars. Il faut bien sûr dire notre reconnaissance à tous ceux qui sont en première ligne ; mais se contenter de remerciements après un attentat, c’est faire comme si tout était normal, comme si rien n’avait raté… Cela contribue à faire croire que ce genre d’attentat, ça arrivera quand ça arrive – le rôle des politiques étant alors seulement de faire en sorte que l’hôpital du coin arrive assez vite pour faire un garrot… Oui, la mission essentielle de la politique, c’est de faire reculer la violence ; et pour cela, elle doit combattre par les moyens de la force publique. Ultima ratio regum : cette force est le dernier argument du prince. A la fin, la politique est inéluctablement une rencontre avec la violence. C’est l’un des grands impensés du monde contemporain.
Vous n’ignorez pas que souvent, les gens disent « Bellamy, il est formidable, il élève le débat, mais il est trop poli, il faudrait qu’il apprenne à renverser la table ». Est-ce que justement, cette pratique bienveillante et polie de la politique que vous essayez d’avoir ne minore pas sa dimension violente ? Est-ce qu’elle n’est pas un peu ingénue ?
Je crois vraiment que dans un monde de brutalisation, d’ensauvagement, qu’on l’appelle comme on voudra, il importe de ne pas se laisser gagner par ce qu’on combat ; vouloir défendre une idée de la civilisation implique de renoncer à la brutalité dans l’exercice même de la vie publique. Non, ce n’est pas être tiède que de croire à la possibilité d’une vie civique qui soit civile, authentiquement civilisée. Et s’imposer cette exigence même quand tout semble consacrer la victoire de l’excès, de la caricature, du faux, c’est le seul choix qui soit assez courageux pour aller vraiment à contre-courant, et la seule manière de parvenir à la fin à « renverser la table » pour de bon. J’espère d’ailleurs que ceux qui me disent trop poli dans mon expression reconnaîtront que cela ne m’a jamais empêché d’être clair dans mes convictions. Il y a des fermetés paisibles et des incohérences bruyantes… On peut chercher à être sensé sans vouloir être consensuel. Je crois à la nécessité du clivage, et j’ai toujours assumé mes engagements ; peut-être à la différence d’autres, qui même chez ceux qui prétendent incarner une forme de radicalité, sont souvent prompts à changer de cap au gré des derniers calculs tactiques. Pour ma part, je pense qu’on peut être efficace sans être opportuniste, et courageux sans être outrancier.
Mais comment être plus efficace tout en restant soi-même ?
D’abord, la politique trouve sa noblesse dans le fait de chercher autre chose que la seule efficacité électorale. Ça ne veut pas dire qu’il ne faille pas chercher des succès électoraux, mais il ne faut pas se renier au motif que le succès serait un but absolu, à tout prix. Je ne suis pas une machine à éléments de langage, et je ne le deviendrai pas. L’efficacité électorale doit être au service d’une vision politique, pas l’inverse. Si je dois mener cette campagne européenne pour les Républicains, mon but sera de revenir au Parlement européen plus nombreux et plus forts pour peser dans les choix essentiels qui s’annoncent. La campagne sera l’occasion de démontrer, avec le bilan de ces cinq ans de mandat, que nous savons comment mener des batailles, et comment les gagner. Je crois avoir démontré au cours des dernières années la pertinence de ce choix, qui n’est pas évident, de rentrer dans le cœur du travail des institutions. C’est la ligne de crête sur laquelle il faut avancer. Beaucoup de gens me disent « Qu’est-ce que vous faites chez LR ? Qu’est-ce que vous faites au Parlement européen ? » Je suis précisément là où je crois que nous devrions tous pouvoir nous sentir représentés. Il n’y a pas de raison de déserter la formation politique qui est supposée représenter nos idées. Il n’y a pas de raison de déserter les institutions où nous devons pouvoir exister. Il n’y a pas de raison d’abandonner le terrain à ceux qui représentent le contraire de nos aspirations. J’espère avoir fait la démonstration que c’était non seulement un pari possible, mais même un pari qui réussit.
Parce que c’est en allant à l’intérieur de ce travail, sans renoncer à rien, qu’on peut réussir à faire avancer les choses. Je pourrais citer beaucoup d’exemples, comme la réforme du marché de l’énergie pour sortir du délire européen qui a fragilisé le nucléaire français : nous allons aboutir à une réforme qui rendra à la France la possibilité de fixer des prix de l’électricité à partir de ses coûts de production, donc de rendre aux Français des factures d’électricité qui ne varieront pas avec le prix du gaz – donc de réindustrialiser le pays, et de lui rendre sa souveraineté. Sur la question de la protection du marché européen avec la barrière écologique qu’on avait promise ; sur l’interdiction de la GPA qui, dans quelques semaines peut-être, sera une réalité en Europe grâce à l’amendement que j’ai déposé ; sur la lutte contre l’entrisme islamiste, en ayant interdit à la Commission européenne de financer les campagnes qui disent que « la joie est dans le hijab »… Évidemment il y a un côté désespérant à être continuellement aux prises avec tout ce qui dysfonctionne, avec tout ce qui contredit nos efforts. Mais avec de l’endurance, du courage, de l’audace, on peut gagner ces batailles.
Mais le paradoxe, c’est que vous êtes dans le lieu de la technocratie tout en étant la quintessence de l’homme politique qui procède plus par vision que par détails techniques. Est-ce qu’il y a un grand écart entre les soirées de la philo et la négociation sur la pêche ?
Un équilibre plus qu’un écart ! J’ai la chance d’avoir la respiration des Soirées de la philo pour garder le contact avec les textes, avec les auteurs. C’est aussi une manière de garder le sens de l’action quotidienne. La vie politique touche aussi au plus fondamental – à une vision de la personne, de la dignité humaine. Si dans quelques semaines, la GPA est considérée dans toute l’Union européenne comme relevant de la traite d’êtres humains et à ce titre interdite, je me dirais que j’aurai eu le privilège de rendre concrets les principes essentiels que nous défendons. Ça ne fait pas tout bien sûr ; ce n’est pas encore la grande refondation que nous espérons pour l’avenir. Mais malgré tout, ne serait-ce que poser des digues, qui permettent de faire la preuve qu’il n’y a pas un sens de l’histoire écrit d’avance, que nous ne sommes pas condamnés à subir l’inéluctable recul des principes qui nous tiennent et auxquels nous tenons, ce n’est pas rien non plus. Et cela, je le dis sans aucun esprit polémique, est directement lié à ce pari de rentrer dans la mêlée, au cœur du travail politique. Moi aussi, je pourrais faire de la politique avec la colère, parce qu’on ne manque pas de colères, et elles sont bien souvent légitimes. Mais que produisent-elles à la fin ?
Je sais que je suis sur une ligne de crête, mais ce qu’on peut apporter à un monde devenu vide, c’est la proposition qu’il attend. Parce que j’ai passé mon temps à râler sur le fait que notre groupe parlementaire ne parlait pas assez de vision et d’idées, notre président de groupe à Strasbourg m’a demandé d’écrire notre nouvelle charte commune : quelle doit être l’identité politique de la droite en Europe aujourd’hui ? J’y ai travaillé avec dix collègues, on a écrit un texte, discuté avec tous les parlementaires du groupe, et finalement adopté… Nous nous plaignons souvent de ne pas être entendus, mais sommes-nous assez capables de parler, de proposer ?
Comment expliquez-vous que ce qui a opéré pour diaboliser l’extrême droite il y a 30 ans n’opère pas du tout avec la France insoumise ?
Si, ça opère. L’Assemblée nationale a rédigé un texte pour exclure les députés de la France insoumise d’une délégation qui part en Israël bientôt. Thomas Portes, le député insoumis qui avait posé avec le pied posé sur un ballon où figurait la photo d’un ministre, a été sanctionné par le bureau de l’Assemblée nationale alors que théoriquement, le bureau de l’Assemblée n’a pas le droit de sanctionner quelqu’un pour ce qui se passe en dehors de l’Assemblée. Au Parlement européen, on avait un texte sur Israël, il y avait des amendements qui venaient de tous les groupes, déposés, par exemple, par le groupe ID auquel appartient le RN et des amendements qui étaient déposés par le groupe The Left auquel appartient LFI. La doctrine de notre groupe, c’est de ne pas pratiquer le cordon sanitaire : s’il y a un amendement du RN qui est bon, on vote pour, ça ne nous pose aucun problème. On a donc voté des amendements d’ID, comme on le fait d’habitude. En revanche, pour la première fois depuis le début du mandat, le groupe a décidé par principe de ne voter aucun amendement venant de l’extrême gauche.
En tout cas, Yael Braun-Pivet s’est porté partie civile pour l’Assemblée contre les propos du député RN Grégoire de Fournas : « que ce bateau retourne en Afrique »… Et on ne l’a pas vue demander une action administrative, même de l’Assemblée, pour sanctionner Danièle Obono après qu’elle a qualifié le Hamas de mouvement de résistance…
Moi, je ne le voudrais pas. On a suffisamment dénoncé la judiciarisation des désaccords pour ne pas tomber à notre tour dans cette impasse. On ne doit pas répondre à une idéologie par une autre idéologie, mais par l’exigence de la vérité, la rigueur intellectuelle, l’intelligence dans le combat culturel. Mais ce combat, nous avons les moyens de le mener avec des arguments, des idées, des faits. Je suis révolté quand Mme Obono dit que le Hamas est un mouvement de résistance, je suis prêt à affronter ce délire autant qu’il le faudra sur le terrain politique, mais je ne demanderai pas aux tribunaux d’assumer ce combat politique à ma place.
Est-ce que cette complaisance de LFI pour le terrorisme, pour les émeutiers, n’illustre pas parfaitement ce que vous dites dans votre chapitre sur le progrès : finalement, pour les gens qui croient au progrès, peu importent violences et destructions du moment que ça fait avancer l’humanité ?
C’est ce que veut dire aussi l’expression de « résistance » : la cause est grande, et c’est juste dommage pour les victimes collatérales. Je me suis beaucoup battu contre nos collègues de LFI qui refusent de parler de terrorisme, mais qui parlent de « crimes de guerre ». Mais crime de guerre, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le Hamas est une armée régulière qui a des objectifs militaires et qui fait, en passant, des victimes collatérales. Mais pire encore que l’idée hégélienne qui voudrait que « tant pis pour les petites fleurs innocentes sur le chemin des grands hommes », il y a la stratégie mélenchonienne : « tout pour arriver au pouvoir », y compris les calculs les plus clientélistes. Qu’est-ce qui est moralement le plus grave ? Est-ce d’être convaincu que le mal est nécessaire ou est-ce de pactiser avec lui par intérêt électoral ? Dans tous les cas, c’est terrifiant.
Dans votre livre vous dites qu’il n’y a pas de progrès en soi, qu’on ne peut juger qu’une chose est un progrès que par rapport au but que l’on s’est fixé. Or l’euthanasie et la GPA, qui nous paraissent d’épouvantables régressions, correspondent pour une partie de nos contemporains, exactement au sens de l’existence qu’ils se sont fixés, c’est-à-dire être de plus en plus maîtres de leur existence. Est-ce qu’aujourd’hui, il n’y a pas sur ces questions-là un affrontement entre deux visions du monde et de la vie, deux anthropologies totalement irréconciliables ?
On pourrait faire une autre hypothèse : c’est qu’en réalité, on trouve dans ces faux progrès de mauvaises réponses à des aspirations légitimes. Être maître de sa vie, par exemple, ne pas subir indéfiniment une souffrance superflue, ce sont des aspirations légitimes. La réponse politique que la société apporte à ces demandes pourrait passer par un surcroît de solidarité, de soins accordés aux plus vulnérables. En réalité, l’euthanasie, c’est pour les politiques la réponse de la paresse.
Dans tous les cas, l’euthanasie est une expérience de dépendance ! Si on demande l’euthanasie, c’est que par définition, on reçoit de l’autre la mort. La vraie question est donc : « Veut-on recevoir de l’autre le soin, ou recevoir de l’autre la mort ? » Une société qui ne sait pas promettre le soin ne peut que proposer la mort. La question que vous posez est importante, et elle n’est pas dépourvue d’incidence concrète dans la discussion politique, parce que le sujet est sans doute aussi de réussir à formuler ce qu’on veut dire. C’est la grande question de Saint-Exupéry : que faut-il dire aux hommes ? Ne devons-nous pas formuler ce que nous voulons promettre à nos contemporains dans le langage de leurs aspirations légitimes, pour montrer que la vraie réponse ne se trouve pas là où on la leur propose aujourd’hui ?
En fait la politique est d’autant plus un dialogue de sourds qu’on s’interdit de poser la question du sens.
C’est la grande question du débat entre Platon et Aristote. Platon regarde la cité comme une masse irrationnelle, la foule étant nécessairement gouvernée par les passions, l’instinct, l’archaïsme de la pulsion. Et il faudrait que cette foule folle soit gouvernée par la petite élite de sages qui savent mieux que les fous quel est leur bien ; il faudrait donc réussir à contrer la folie du peuple pour imposer à sa tête la sagesse du petit nombre. Aristote pense, lui, et je ne serais pas loin d’être aristotélicien sur ce point, que l’esprit humain est tourné vers le vrai comme le tournesol vers le soleil et que, si le grand nombre pense quelque chose, il y a de grandes chances que le grand nombre ait raison – dans certaines conditions, et la condition absolue, c’est notamment l’éducation. Dans ces conditions, le peuple partage ce que l’on peut appeler le bon sens, ou le sens commun. Et quand on pense avoir raison seul contre tous, dit Aristote, il faut toujours commencer par s’inquiéter de soi-même, parce qu’il est rare d’avoir vu tout seul une vérité que personne n’aurait perçue. Donc, le sujet est plutôt de réussir à montrer comment ce que nous avons à offrir correspond aux aspirations du plus grand nombre, plutôt que de dire au plus grand nombre que ses aspirations sont mauvaises.
Vous parliez des batailles qu’on peut gagner de manière inattendue.. En fait, pour vous, le plus grand ennemi, c’est la résignation ?
Il y a une grande lâcheté, en tous les cas, dans la résignation. Bernanos fustige les optimistes, ce qui m’a toujours plu parce que je suis allergique à l’optimisme béat ; mais il fustige aussi les pessimistes. Le vote macroniste, aux dernières élections, réunissait des électeurs qui se disaient optimistes. Pour nous, nous avons peut-être par contraste une tendance au pessimisme. Or, le pessimisme est aussi une manière de se défaire de sa responsabilité. Parce que si nous concluons toutes nos conversations par le fait que de toute façon, tout va finir par s’effondrer, alors pourquoi agir ? On vit sans doute une des périodes les plus critiques de l’histoire de notre pays, au sens étymologique de la crise, qui veut dire la croisée des chemins. C’est de ce que nous déciderons dans les années qui viendront que dépendra l’avenir à long terme de la France, et sa survie même. Si nous regardons l’histoire de notre pays, de notre civilisation, nous verrons qu’ils ont survécu à des moments plus sombres que ceux que l’on traverse aujourd’hui, par des actes d’espérance, qui ont toujours été des sursauts suscités par le courage de quelques-uns.
On vit sans doute une des périodes les plus critiques de l’histoire de notre pays, au sens étymologique de la crise, qui veut dire la croisée des chemins. C’est de ce que nous déciderons dans les années qui viendront que dépendra l’avenir à long terme de la France, et sa survie même.
Certes, mais là, on a vraiment l’impression de vivre quelque chose d’unique et de sans précédent, c’est-à-dire que d’être dans un monde qui ne sait plus du tout quels sont ses fondements et qui ne croit plus à rien. Certes, l’espérance est un exercice de la volonté, mais si la volonté ne trouve pas des raisons concrètes sur lesquelles s’appuyer, elle risque de s’épuiser…
Mais une fois qu’on fait cet acte d’espérance, les raisons apparaissent sous nos yeux. Depuis le début du mandat, je vais un peu partout dans le pays, une ou deux fois par semaine, et j’y rencontre partout des Français exceptionnels. Il y a dans ce pays, quels que soient leur profession, leur milieu social, leur horizon, chez ceux qui travaillent, qui font que la France tient debout, qui restent encore fidèles malgré toutes les difficultés, un potentiel magnifique qui n’attend que d’être enfin libéré.
Une autre raison d’espérer, c’est ce qui se passe sur le terrain des idées. Oui, la gauche garde de grands bastions culturels. Oui, les multinationales du numérique diffusent une vision du monde qui contribue à la déconstruction. Mais aujourd’hui, le débat est quand même bien plus ouvert qu’il ne l’a été dans le passé. La discussion reste bien plus libre en France que dans d’autres régions du monde. Et sur le terrain médiatique, votre travail, je le dis sans facilité, est aussi une raison d’y croire encore. Sans rien occulter de ce que nous avons dit de la gravité de la situation, il y a des expériences auxquelles accrocher notre espérance – celle que j’ai vécue il y a quelques jours à l’occasion des dix ans des Soirées de la Philo : devant 2 000 personnes, dont énormément de jeunes, venues écouter du Plotin sur la scène de l’Olympia, on ne peut que se dire : « Ce n’est pas complètement mort ». Rien n’est gagné d’avance, bien sûr ; mais au fil des rencontres que je vis partout en France, je vois dans bien des regards assez d’énergie, d’intelligence et de volonté pour mener les combats qui viendront. Marc Aurèle écrit, dans Les pensées pour moi-même : « Les batailles que je n’ai pas livrées, je me console trop facilement dans la certitude qu’elles étaient perdues d’avance. »
Partagez cet entretien !











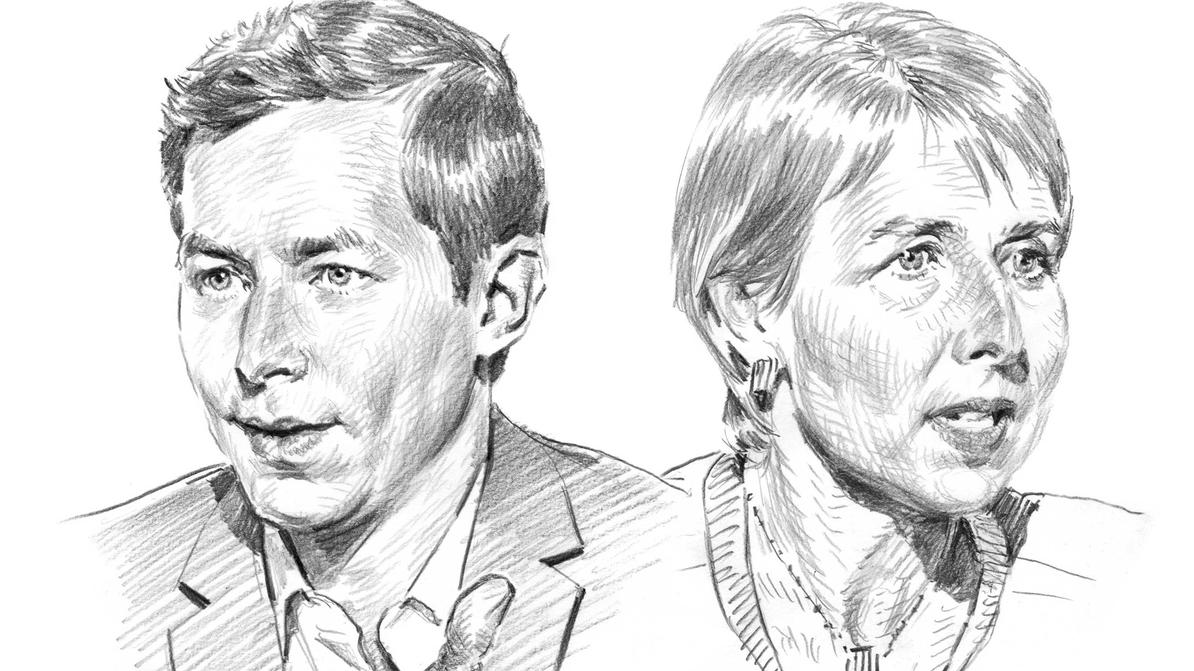





 Débat avec Alain Finkielkraut pour Le Figaro Magazine. Propos recueillis par Alexandre Devecchio et Pierre-Alexis Michau
Débat avec Alain Finkielkraut pour Le Figaro Magazine. Propos recueillis par Alexandre Devecchio et Pierre-Alexis Michau