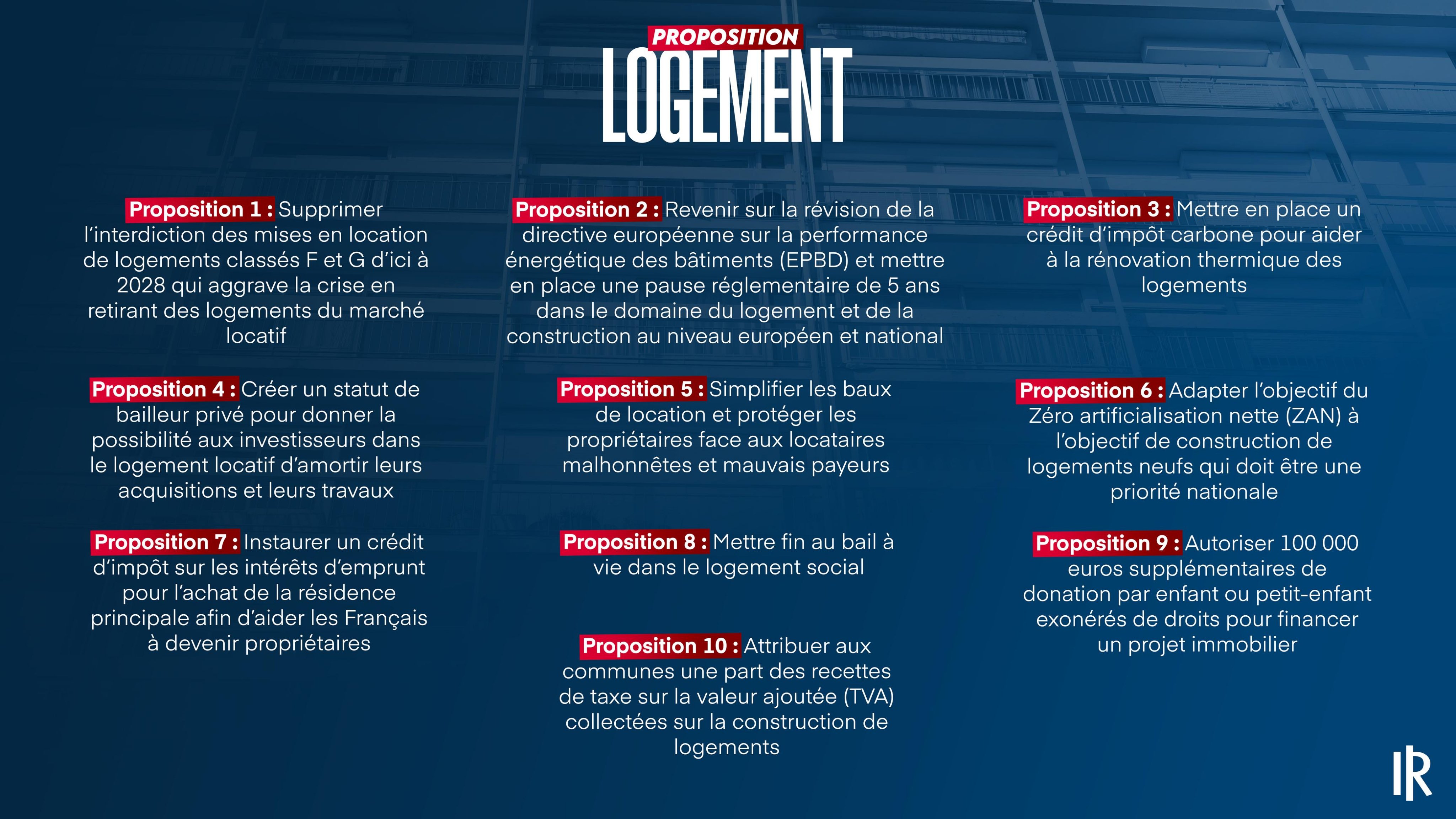Pour un principe de non-régression économique en Europe

Tribune parue dans l’Opinion en mai 2024
Face au décrochage économique de l’Europe, la tête de liste de LR pour les élections européennes, qui dévoile mardi son projet européen, plaide pour qu’aucun projet « entravant la production et l’activité économique » ne puisse être approuvé au sein de l’UE.
Au moment où l’Europe doit affronter des défis géopolitiques inédits, il est temps de prendre enfin conscience que nous perdrons toute capacité d’agir si nous laissons se poursuivre le double décrochage économique qui s’accélère sous nos yeux : celui de l’Europe dans le monde, et de la France en Europe. Alors que l’Europe pesait un poids économique équivalent à celui des Etats-Unis et nettement supérieur à celui de la Chine en 2010, l’écart est désormais de 80% en faveur des Etats-Unis, tandis que la Chine nous a rattrapés.
L’Union européenne était structurellement une puissance exportatrice :
Elle a accusé en 2022 un déficit commercial de plus de 400 milliards d’euros, certes lié à la crise énergétique mais, plus structurellement, aux multiples entraves à la production qui ont été le résultat des politiques européennes ces dernières années.
Qu’il s’agisse de l’agriculture, avec les projets Farm to Fork et restauration de la nature, de l’énergie, par la lutte acharnée contre l’énergie nucléaire, ou plus généralement de l’industrie, livrée à une concurrence déloyale de la Chine et minée par nos propres décisions – comme l’interdiction des véhicules thermiques d’ici 2035, le bilan est catastrophique.
Une inflation normative aberrante fait désormais peser un risque pénal sur tous les chefs d’entreprise, avec par exemple les directives CSRD ou Devoir de vigilance, votée en avril dernier par cette coalition récurrente alliant l’extrême gauche, les socialistes, les verts et les macronistes. Sursaut.
Nous n’avons cessé de nous opposer à ce projet de décroissance :
Le sursaut est désormais urgent, et doit être concret. Au principe de non-régression écologique si souvent mobilisé, nous voulons adjoindre un principe de non-régression économique, industrielle et agricole. Aucun projet entravant la production et l’activité économique ne doit pouvoir être approuvé ; et le prochain parlement devra soumettre à ce critère l’ensemble des directives et règlements existants qui pèsent sur nos entreprises.
Ce travail essentiel, dans lequel je compte m’investir personnellement, ne pourra être mené que par des députés européens réellement investis, pas par des touristes parlementaires absents de tous les combats qui comptent. Mais ce décrochage économique dans le monde ne doit pas masquer celui de la France au sein de l’Europe.
Derrière la mise en scène des investissements étrangers en France, la réalité est que nous affichons le déficit commercial le plus important de tous les pays européens, de 100 milliards d’euros en 2023 après le record historique de 162 milliards d’euros en 2022.
Nous sommes le troisième pays le plus endetté de l’UE après la Grèce et l’Italie, et notre trajectoire budgétaire est bien plus préoccupante.
La France s’enfonce dans la dérive de ses finances publiques et dans la consommation à crédit, la faute à des dépenses publiques hors de contrôle et aux prélèvements obligatoires les plus élevés de l’OCDE. Dans cet enfer fiscal, la France qui travaille voit ses efforts confisqués pour financer des dépenses irresponsables, en particulier par les minorités de blocage qui continuent à imposer leur chantage comme si de rien n’était.
Même les Jeux olympiques deviennent une occasion pour exiger des privilèges.
L’accord entre la SNCF et ses syndicats, qui revient à ne pas appliquer la réforme des retraites, est un vrai crachat au visage des salariés, du privé comme du public, qui paient deux fois pour la dérive de ce corporatisme irresponsable, comme contribuables et comme clients. Un tel hold-up n’est possible que par la lâcheté de la quasi-totalité de la classe politique française : la majorité fait semblant de découvrir le problème pour ne pas avoir à y toucher, et le RN prend comme la gauche le parti de Sud Rail, contre une majorité silencieuse que personne ne semble vouloir écouter.
Trop, c’est trop : pour rompre avec cette surenchère, le gouvernement doit exiger de la SNCF qu’elle annule cet accord, et se saisir enfin de la proposition de loi soutenue au Sénat par la droite et le centre limitant les grèves dans les transports publics, comme en Italie. La faute originelle du macronisme a été de céder aux zadistes de Notre-Dame des Landes, abandonnant le droit et la démocratie à une occupation violente.
Si cette logique n’est pas renversée maintenant, c’est le relèvement du pays qui s’en trouvera durablement compromis. Il est temps que la France qui travaille cesse enfin de subir en silence ; c’est la mission de la droite d’en être le porte-voix.