
Quelques jours avant la parution, le 7 avril [2016], d’un livre de Luc Ferry consacré au transhumanisme (La révolution transhumaniste, Plon), long débat sur cette question décisive, paru dans les colonnes du Figaro Magazine. Propos recueillis par Patrice de Méritens.
.
Le Figaro – Comment définissez-vous le transhumanisme ? D’où vient-il ?
Luc Ferry – Le transhumanisme est un rejeton de la troisième révolution industrielle, celle du numérique et des fameuses NBIC : nanotechnologies, biotechnologies, informatique et cognitivisme (l’intelligence artificielle). Il se caractérise par trois traits fondamentaux qui risquent de bouleverser nos vies. D’abord, le projet de passer d’une médecine thérapeutique à une médecine de « l’augmentation », notamment par le biais de l’ingénierie génétique et de l’hybridation. Un exemple ? La vision peut être aujourd’hui rendue à des aveugles par implantation d’une puce électronique derrière la rétine. Là, on reste encore dans le cadre thérapeutique. Mais, le jour où cet implant permettrait de nous donner une vue d’aigle, alors la concurrence entre les armées, par exemple, voire entre les familles, pourrait faire passer du thérapeutique à l’augmentatif. Le deuxième trait du transhumanisme, c’est un nouvel eugénisme dont la formule est « From chance to choice » : il s’agit de passer des aléas très inégalitaires de la loterie génétique au choix délibéré d’une amélioration de l’humain grâce à l’ingénierie génétique. On en est loin encore, mais la science progresse tellement vite qu’il n’est pas impossible qu’on y arrive un jour. Le dernier trait – symbolisé par la filiale de biotechnologies de Google, Calico – vise carrément l’augmentation de la vie humaine. Pour une vingtaine d’années dans un premier temps, avec, pour projet à long terme, de lutter contre le vieillissement et la mort. L’université de Rochester vient de réussir à augmenter de 30 % la vie de souris transgéniques. Attention, pas de délire : les humains ne sont pas des souris, mais le projet de faire pour eux la même chose est là, financé de manière colossale par Google, ce qui doit nous inciter à y réfléchir dès maintenant.
François-Xavier Bellamy – Cette révolution ne compte pas seulement bouleverser nos vies, elle transforme l’idée que nous nous faisons de l’homme. Pallier une rétinite par le biais d’un implant, c’est rendre à l’homme ses deux yeux, le reconduire à l’équilibre naturel des corps humains. Se faire greffer un troisième œil derrière la tête serait totalement différent ; en fait, le transhumanisme se fonde sur une anthropologie de la frustration : vouloir « augmenter » l’humain, c’est le considérer comme un être déficient. Depuis toujours, la médecine thérapeutique voulait réparer la nature ; le transhumanisme veut la détruire. Dès lors que la technique quitte la médecine pour basculer dans l’augmentation, c’est son mépris de la faiblesse et de la fragilité qu’elle trahit, et c’est à nous-mêmes que nous déclarons la guerre…
L. F. – La technomédecine et l’ubérisation de la planète vont bouleverser nos vies et le monde de la technique nous submerge : ses avancées sont si rapides et si difficiles à comprendre qu’elles échappent aux politiques comme aux opinions publiques. Avec ses milliers de laboratoires et de leviers de décision, la technoscience échappe presque à tout contrôle, et ce que nous régulerons en France ne fixera rien en Corée ou en Chine. D’où l’avertissement des « bio-conservateurs » tels que Francis Fukuyama ou Michael Sandel, qui appellent à anticiper. Qui aurait pu dire il y a seulement cinquante ans qu’un ordinateur battrait le champion du monde de go ? Et qui peut dire ce que seront les biotechs en 2300 ? Leur augmentation exponentielle nous approche des limites technologiques de la démocratie, et c’est un problème politique : on ne pourra ni tout interdire ni tout autoriser, il faudra repenser de fond en comble la notion de régulation et pas seulement au niveau national. Il existe, pour se repérer en éthique, deux grandes traditions humanistes. L’humanisme chrétien qui, avec saint Thomas, privilégie l’idée de loi naturelle. L’humanisme laïc, celui de Pic de La Mirandole et de Condorcet : il définit l’humain non par ses qualités naturelles mais, au contraire, par sa liberté, par sa faculté de transgresser la nature de sorte qu’il est capable d’une perfectibilité infinie, y compris sur le plan biologique. C’est à la fois fascinant et effrayant. Car si la mort et la vieillesse sont naturelles, lutter contre elles ne l’est pas moins : quand le médecin vous annonce un cancer du pancréas, d’un coup, vous regardez d’un œil moins critique les possibilités que le transhumanisme prétend offrir un jour à une humanité augmentée…
F.-X. B. – Non ! Vous espérez la guérison, et vous avez raison. Rien à voir avec le transhumanisme… On peut vouloir un corps humain en bonne santé, sans courir derrière un corps surhumain – et du même coup inhumain… Vous évoquez « l’humanisme » des transhumanistes mais, dans la volonté de refuser que l’homme partage une nature commune, je vois plutôt une forme d’antihumanisme. C’est au fond la haine de l’homme dans les finitudes qui définissent sa condition – dans sa fragilité, dans la vieillesse, la maladie et la mort. Et pourtant, les dernières découvertes de la chronobiologie montrent combien ces limites font partie de nos vies – jusque dans nos cellules, dont Jean-Claude Ameisen décrit le renouvellement permanent comme une inscription de l’éphémère au cœur de la vie. Voilà notre condition. Nous sommes des vivants aussi par la mort. Il est bon que la médecine lutte pour la vie ; mais elle reniera la vie humaine quand elle tentera de supprimer la mort. Quand nos corps mortels seront remplacés, organe par organe, par des pièces de machine, serons-nous encore humains ? Serons-nous vraiment vivants ? C’est là tout l’enjeu anthropologique, dont il faut que la politique se saisisse dès maintenant.
Le danger, en effet, serait que nous ouvrions les yeux quand les grandes mutations seront déjà faites. Tout l’enjeu est aujourd’hui de reprendre le pouvoir sur notre propre pouvoir. C’est en redécouvrant le sens de l’humain que nous pourrons retrouver la maîtrise de notre destin commun.
L.F. – Je crois que la guerre contre la nature a une part de légitimité. Rien n’est moins naturel que la civilité, que la démocratie, que la science…
F.-X. B. – Je pense, avec Platon, que la guerre contre la nature est désastreuse. C’est, dans le Gorgias, la question de Calliclès contre Socrate : ne faut-il pas dépasser toutes les limites pour satisfaire ses désirs ? Pour Socrate, cette guerre contre la mesure que nous impose la nature nous condamne en fait au malheur, car elle ouvre une surenchère permanente : nous n’en aurons jamais assez. Nous voilà donc prisonniers de nos fantasmes, contraints à une course infinie, et donc vaine – quand bien même on l’appellerait « progrès ». Il faut choisir de recevoir et de contempler – ou bien dissoudre sa propre vie dans une fiction. La révolte contre la nature est une malédiction que nous nous infligeons à nous-mêmes.
L. F. – Vous êtes un humaniste chrétien et je me place dans le second humanisme, celui qui pense qu’à la différence des animaux, l’être humain n’est pas emprisonné dans un programme naturel, comme l’abeille qui est préformée pour fabriquer du miel, ou mon chat pour chasser les souris, sans pouvoir jamais s’émanciper de ce logiciel de la nature. Je suis plus du côté de Protagoras que de Platon dans l’idée que le meilleur de l’humain consiste justement à s’affranchir de la nature. Tout est-il permis pour autant ? Evidemment, non ! Le fameux « Il est interdit d’interdire » de 1968 est la plus grande ânerie de l’histoire humaine ! Le défi de l’humanisme laïc est justement de fabriquer des limites spécifiquement humaines, non naturelles. Et c’est là le sens du fameux précepte républicain selon lequel « ma liberté doit s’arrêter là où commence celle des autres ». Il paraît anodin, mais il est en vérité d’une profondeur abyssale : il signifie que les limites sont construites par l’être humain, son intelligence et sa liberté, et non imposées par la nature ou par Dieu. Toute la démocratie et toute la médecine se construisent contre la nature. Le virus du sida tout comme la pandémie de grippe qui a tué 20 millions de personnes en 1918 sont naturels. La nature n’est jamais un modèle moral. Comme disait Spinoza, dans la nature les gros mangent les petits…
F.-X. B. – Pour le coup, je serai en profond désaccord avec vous. La médecine thérapeutique, pour ne parler que d’elle, ne se construit jamais contre la nature.
L. F. – Et les antibiotiques ?
F.-X. B. – Les antibiotiques ne font qu’utiliser, finalement, les réactions naturelles du vivant.
L. F. – Non, le mot même indique qu’on tue des microbes absolument naturels.
F.-X. B. – Mais on le fait pour rétablir cet équilibre naturel du corps qui se nomme la santé ! Si la médecine intervient, c’est pour restaurer la nature dans son cours ordinaire. Les maladies sont des accidents de la nature.
L. F. – Vous plaisantez ! Les maladies, comme la vieillesse et la mort, sont, du point de vue de la totalité de la nature, parfaitement naturelles. Elles n’en sont pas moins des fléaux. La nature comprend tout, le pire comme le meilleur, ce pourquoi l’éducation de nos enfants n’a rien de naturel. Spontanément, nos enfants moquent les différences, les handicaps, ils sont égoïstes et impolis et, croyez-moi, l’apprentissage de la civilité est tout sauf naturel parce que la nature est le contraire absolu d’une norme morale !
F.-X. B. – Au contraire… L’éducation pourrait se définir par la maxime du classicisme : « Combien d’art pour rentrer dans la nature ! » L’éducation, c’est le travail de la culture qui permet à l’enfant d’accomplir sa propre nature. Il y a quelque chose de profondément naturel chez l’homme dans la civilité, par exemple : par l’exercice bien sûr, par l’artifice, elle nous apprend à être authentiquement humains et fait échapper notre nature profonde à l’immédiateté des pulsions, à la facticité du caprice. Pourquoi, sinon, choisir la morale ?
L. F. – Vous défendez la conception grecque et thomiste de la vertu comme actualisation de dispositions naturelles, et c’est bien votre droit. Mais, de mon point de vue d’humaniste laïc, c’est tout l’inverse : la nature est aveugle, injuste, elle ne connaît que la force brute et la vertu morale consiste, non à l’actualiser, à la suivre, mais au contraire à lutter contre elle. Ce qu’il y a de grand dans l’être humain, c’est sa liberté, son travail et ses efforts, pas sa nature, hélas ! Il n’y a donc aucune raison de ne pas vouloir la corriger ou l’améliorer parfois. Si on pouvait accroître de vingt ans la vie de ma mère, je serais preneur. La vraie question pour moi est bien plus complexe et c’est celle-ci : à quel prix ? Si l’ingénierie génétique fonctionne un jour, elle pourra remettre en cause la définition même de l’humain comme être libre, et c’est un grand danger. Plutôt que des ministères aux intitulés débiles, « l’habitat durable » ou « l’égalité réelle », il faut dès maintenant que les politiques se réveillent sur ces questions. On ne saurait modifier une partie de l’espèce humaine sans que le reste en soit affecté. Tout mon livre plaide pour une régulation qui doit être politique.
F.-X. B. – Le technicisme qui voudrait faire croire que tous les problèmes seront réglés par le progrès technique est en effet absurde. La technique ne fait que déplacer les difficultés. Elle ne peut apporter des réponses qu’à des questions qui se formulent en amont de la technique. Le transhumanisme n’est une solution que si nos corps sont perçus comme un problème… Il faut donc résister à ce que Carl Schmitt appelait la neutralisation du monde, l’idée qu’au fond la technique pourrait dissoudre la politique dans des solutions préconstruites. Nos débats politiques cèdent déjà trop souvent à cette facilité en demandant aux « experts » de résoudre pour nous les problèmes. Les vraies questions ne sont pas techniques. Il ne s’agit pas seulement par exemple de trouver comment augmenter la vie, mais de savoir si nous le voulons vraiment : cela nous concerne tous.
L. F. – La technophilie est souvent absurde, en effet, naïve et dangereuse, mais tout dépendra de l’usage qu’on en fera. Allons-nous enrichir l’humain ou l’appauvrir ? C’est toute la question.
F.-X. B. – Quand nous porterons des cœurs qu’on changera tous les cinquante ans, nous n’aurons pas prolongé la vie, nous aurons supprimé la mort. Serons-nous encore des humains ? La condition pour la survie de l’humanité sera de ne plus avoir d’enfants, pour une simple raison de place et de richesses à exploiter. Une vie sans générations, est-ce encore une vie humaine ? Et cette vie sera-t-elle vraiment la nôtre ? C’est la question que posait Jorge Luis Borges dans L’Immortel : si vous avez devant vous un temps infini, il n’y a plus rien que vous seul puissiez faire. La limite qui marque le temps de la vie est aussi la condition de la créativité. Arendt décrivait la natalité comme la condition de toute nouveauté dans le monde.
Il y a enfin une dernière raison de craindre que le transhumain ne soit, en fait, l’inhumain : le jour où nous arriverons à supprimer la mort, se posera la question de notre type de société. Ne vivrons-nous pas une régression vers la barbarie, quand ceux qui en ont les moyens s’augmenteront, pendant que les démunis n’auront qu’à disparaître ? Nous finissons par céder à une caricature de ce que vous appeliez « la nature », avec notre eugénisme techniciste qui veut supprimer les imparfaits par haine de l’imperfection.
L. F. – Il n’y a rien de pire que la technophilie, sinon la technophobie ! La loi de Moore s’applique aussi à la nouvelle économie. Le premier séquençage du génome humain a coûté 3 milliards de dollars en 2000, il en coûte environ 1 000 aujourd’hui. Quant à la victoire sur la mort, c’est un pur fantasme. Nous finirons toujours par mourir, fût-ce par accident ou par suicide. Nous resterons mortels. Le propre de l’homme s’enracine-t-il pour autant dans une nature figée et intangible, de sorte qu’en bousculant cette nature on modifie aussi ce qui en dépend, à savoir la morale ? C’est votre hypothèse et celle de Fukuyama. Mais si on pense au contraire que l’être humain est perfectible à l’infini, que sa liberté transcende la nature, alors l’idée d’augmenter la longévité devient plutôt joyeuse ! Il y a tant de livres à lire, tant d’hommes et de femmes à aimer qu’une espérance de vie de 300 ans m’enchanterait ! J’entends dire : « Quelle horreur, on va s’ennuyer, est-ce qu’on aimera encore ? » Mais pas du tout ! On aimera, on apprendra, on s’améliorera. Et, si vous n’en voulez pas, n’en dégoûtez pas les autres…
F.-X. B. – Toucher à l’espèce humaine concerne tout le monde. On ne saurait donc dire à ceux qui sont méfiants face à ce nouvel univers qu’ils n’ont qu’à se mettre à l’écart. Si le projet est de construire un monde d’ennui dont la seule perspective de sortie soit le suicide ou l’accident, je ne vois pas où est le progrès qu’on nous vend !
L. F. – C’est en tout cas un monde de liberté. Je ne suis ni transhumaniste ni partisan du suicide, mais l’utopie d’une perfectibilité infinie des humains qui pourrait, pourquoi pas, transformer le monde en paradis ici et maintenant, ne me déplaît pas. Nous en sommes si loin, si loin d’être au niveau de notre liberté !
F.-X. B. – La promesse du paradis, ici et maintenant, est la voie la plus sûre vers l’enfer immédiat… La religion comme la philosophie savent que l’homme n’est jamais pleinement au niveau de sa liberté !
L. F. – Mon Dieu, pourquoi les chrétiens devraient-ils se scandaliser à l’idée de faire descendre un peu de leur idéal, celui de la « mort de la mort », du ciel vers la terre ?
F.-X. B. – La mort de la mort par la vie authentique de la conscience, non par l’inerte matérialité d’artifices techniques déjà morts…
.
Retrouver le dossier complet sur le transhumanisme sur le site du Figaro.





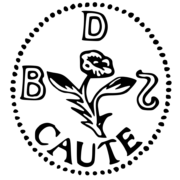



 Chaque année, le site
Chaque année, le site 