Reconstruire une droite claire, pour rendre enfin possible l’alternance
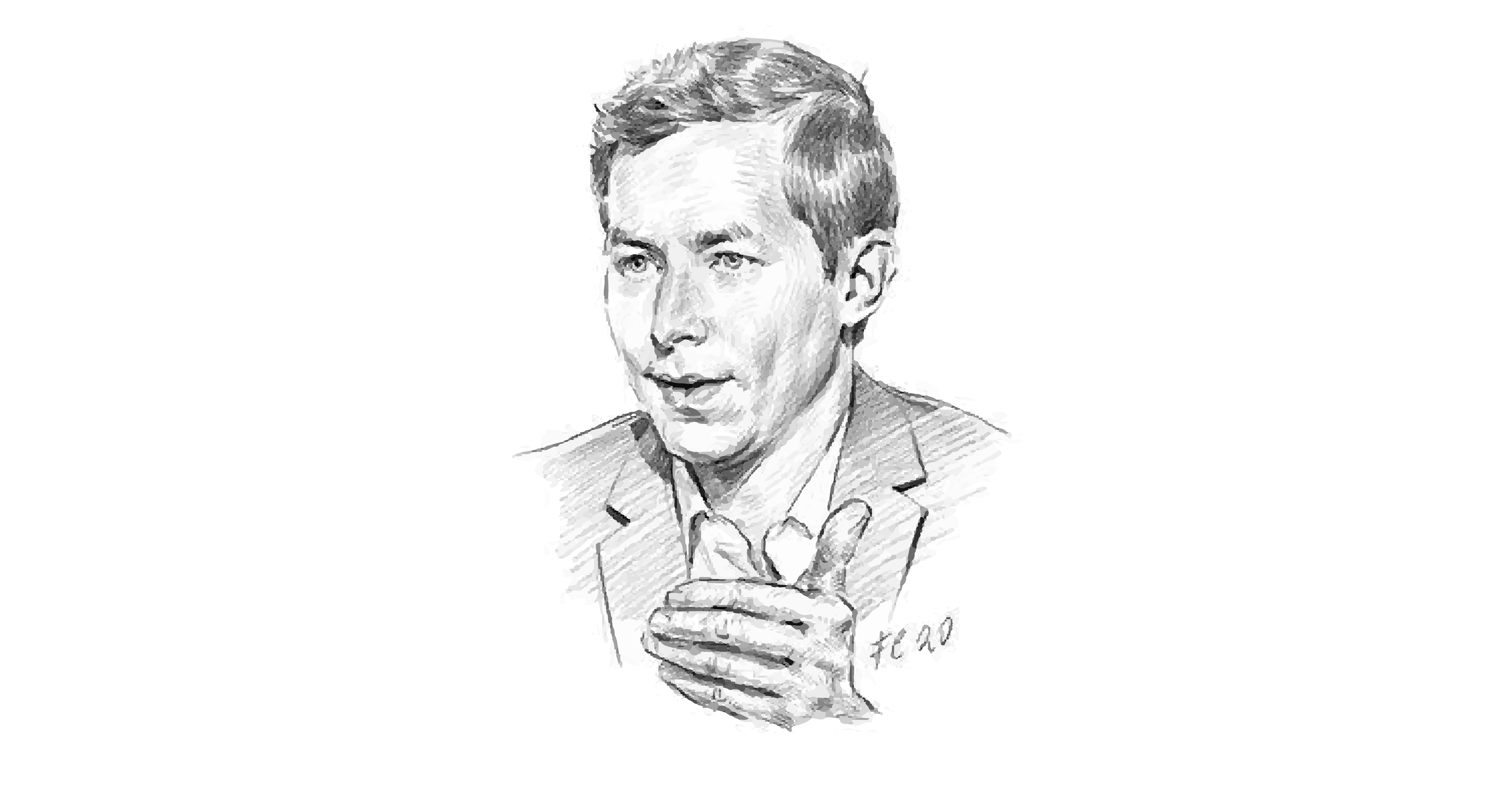 Où va la France ? Le malaise démocratique qu’elle traverse depuis longtemps n’a pas été résolu par la dissolution, au contraire, ni par les élections qui ont suivi. Ce pays, qui n’a jamais autant aspiré à la fermeté, à la sécurité, à la maîtrise des frontières, à la liberté et à la prospérité retrouvées, pourrait se trouver gouverné par une gauche archaïque dont l’attelage indéfendable ne tient que par le déni de réalité sur ces enjeux existentiels. Comment en sommes-nous arrivés là ? Avant d’agir, il faut commencer par comprendre ce qui vient de se produire.
Où va la France ? Le malaise démocratique qu’elle traverse depuis longtemps n’a pas été résolu par la dissolution, au contraire, ni par les élections qui ont suivi. Ce pays, qui n’a jamais autant aspiré à la fermeté, à la sécurité, à la maîtrise des frontières, à la liberté et à la prospérité retrouvées, pourrait se trouver gouverné par une gauche archaïque dont l’attelage indéfendable ne tient que par le déni de réalité sur ces enjeux existentiels. Comment en sommes-nous arrivés là ? Avant d’agir, il faut commencer par comprendre ce qui vient de se produire.
Nos démocraties occidentales sont partout confrontées à la même crise intérieure : le relativisme vide de son sens la parole publique, l’obsession de la communication prend le pas sur la nécessité de l’action, l’effacement du réel détache la politique de la vie.
Il y a sept ans, Emmanuel Macron a proposé aux Français le pari du « dépassement des clivages ». De la fatigue des appareils qui avaient structuré le débat politique pendant plusieurs décennies, il a tiré la promesse de mettre fin aux querelles de l’ancien monde, réputées artificielles et périmées. Il faudrait désormais être « en même temps » de droite et de gauche, et tous unis contre « les extrêmes ». Ce chemin ne pouvait être qu’une illusion. L’engagement politique n’est rien d’autre que le service de la décision : dans quelque mandat que ce soit, la mission du politique est de faire des choix au nom de la cité, c’est-à-dire de renoncer – on ne peut jamais tout choisir « en même temps »… Et la noblesse de la démocratie, c’est que les élus reçoivent ce mandat après avoir assumé la vision qui guidera leurs arbitrages. Les différences, les désaccords, les divergences ne sont pas un accident dans une démocratie ; ils sont le principe même du pluralisme. Et la confrontation entre ces deux visions du monde, ces deux tempéraments politiques qui distinguent la droite et la gauche, revient d’une manière ou d’une autre dans toute conversation civique libre et ouverte. Vouloir « la fin des clivages » et le « en même temps », c’était donc de toute évidence préparer une aggravation sans précédent du malaise démocratique profond que vivent les Français.
Car les clivages n’ont pas disparu, au contraire. Et depuis 2017, derrière les artifices de communication et les débauchages individuels, c’est en réalité la politique de la gauche qui s’est largement poursuivie. Refus d’une vraie réponse pénale contre l’explosion des violences ; fragilisation de l’enseignement des savoirs fondamentaux, qui aggrave la crise de l’école ; records d’immigration légale et illégale chaque année ; record historique des prélèvements obligatoires, des déficits et de la dette publique : il y a bien longtemps que la France n’a pas connu l’alternance, malgré l’évidence du déclin auquel cette trajectoire la conduit.
Le RN, en proclamant lui aussi la fin du clivage droite-gauche, adopte le récit macroniste.
Pourquoi ce paradoxe ? Le discrédit qui touche la droite, sa difficulté à se remettre en question et à se renouveler vraiment, a conduit une majorité des électeurs qui veulent le changement vers le Rassemblement national. C’était aussi le projet d’Emmanuel Macron, qui a tout fait pour rester seul face à cet adversaire idéal. Car le RN, en proclamant lui aussi la fin du clivage droite-gauche, adopte le récit macroniste. Avec les mêmes méthodes, et le même résultat : derrière la surenchère de communication, à la fin, c’est toujours la gauche qui gagne. Dimanche soir, par un retournement improbable, le Nouveau Front populaire arrivait en tête de l’élection législative…
On pourra bien sûr épiloguer longtemps sur les accords indécents qui ont vu des figures de la majorité macroniste soutenir une alliance de candidats compromis avec l’antisémitisme, la violence, l’autoritarisme. Mais ce que montre un tel résultat, c’est d’abord que le RN est et reste le meilleur instrument pour une gauche qui grâce à lui, sous des formes différentes, reste indéfiniment au pouvoir. Pour une raison très simple : ses propres choix en ont fait un parti incapable de rassembler au second tour, quand bien même son programme correspondrait à des aspirations majoritaires dans l’électorat. Ce n’est pas par un défaut conjoncturel ou par l’adversité de ses opposants, mais par l’identité politique que cette formation s’est choisie. Demain comme hier, c’est face à lui qu’un pouvoir pourtant en échec et minoritaire dans le pays aura toujours le plus de chances de l’emporter. Les candidats de droite qui ont eu le courage de s’engager malgré l’épreuve et qui se sont qualifiés au second tour ont démontré au contraire qu’ils étaient, partout en France, les plus capables de l’emporter.
Comment prétendre réunir la droite en refusant d’être de droite ?
Cela ne peut que rendre plus nécessaire un chemin difficile, mais le seul qui puisse conduire demain à l’alternance dont la France a tant besoin : la reconstruction d’une offre politique de droite, solide, sérieuse, exigeante. Qui s’impose enfin un renouvellement profond pour reparler aux Français au-delà des fractures sociologiques ou géographiques du pays. Qui assume le clivage politique, avec le courage de la cohérence et de la vérité : nous ne retrouverons pas la maîtrise de notre destin, y compris de nos frontières, sans relèvement économique, et sans liberté retrouvée. Comment prétendre rompre avec le macronisme en adoptant la même stratégie de l’ambiguïté ? Comment promettre de sortir du déclin en misant sur la démagogie ? Comment prétendre réunir la droite en refusant d’être de droite ? Bien sûr, les étiquettes politiques ne sont pas une fin en soi, mais seule une ligne claire pourra déterminer l’action qui relèvera le pays, et pour cela d’abord réunir les Français. La droite n’est pas prête encore pour ce travail qui l’attend, mais la leçon de dimanche soir est pourtant que, comme partout en Europe, c’est elle seule qui peut rendre possible ce renouveau. C’est la raison pour laquelle, avec persévérance, il nous faut nous accrocher plus que jamais au devoir de la reconstruire, non pour un parti, mais pour le pays.






 Texte initialement paru dans Le Figaro du 16 octobre 2023.
Texte initialement paru dans Le Figaro du 16 octobre 2023.
