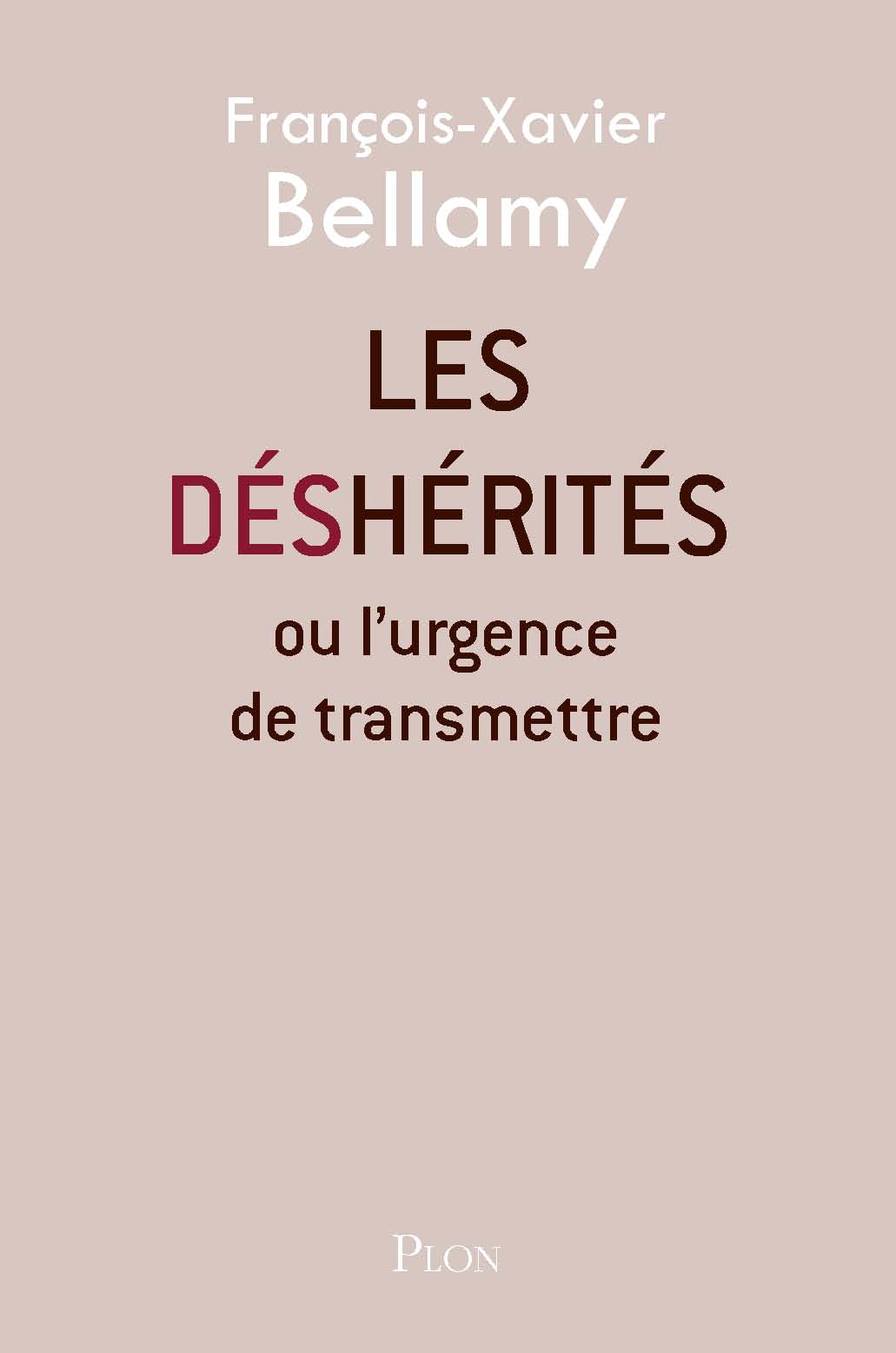Une certaine idée de la gratitude
François Hollande a confirmé ce matin qu’il voulait faire de l’école une arme pour lutter contre la menace que nous pressentons, celle de la désagrégation de la France.
L’école est capable, c’est certain, de contribuer à l’unité de notre pays. Mais elle ne le peut que si elle renoue avec l’enseignement de sa langue, de sa culture, de son histoire, qui doivent redevenir notre priorité concrète – comme j’ai tenté de l’expliquer dans l’Opinion récemment.
Depuis la publication des Déshérités, j’ai reçu de très nombreux courriers. L’un d’entre eux m’a particulièrement marqué : c’est le message d’un jeune malien de 22 ans, avec qui je suis resté en relation depuis. Sa réaction montre bien que c’est la transmission de notre culture, indépendamment de toutes les origines – et même au-delà de nos frontières ! – qui peut seule susciter l’adhésion passionnée à la France.
Si tous les jeunes Français pouvaient exprimer ce que vit, pense et ressent Ladji à l’égard de la France – et s’ils pouvaient l’écrire aussi bien que lui ! – il ne fait aucun doute que notre pays ne vivrait pas les déchirements et les angoisses qu’il traverse aujourd’hui.
Avec son autorisation, je reproduis ici son magnifique témoignage. Dans une très belle langue, il dit ce qui doit nous réunir, et nous appeler à transmettre l’essentiel : « Une certaine idée de la gratitude ». C’était le titre de son message… Le voici :
« Bonjour Monsieur,
Je m’appelle Ladji Samba K., né au Mali en 1992, et élevé dans l’admiration de la France. D’une certaine idée de la culture Française. D’où mon immense gratitude envers votre livre, cet éloge de la modestie, donc de la transmission.
J’ai connu la France par les livres, par un professeur de Français admirable qui nous faisait lire La Fontaine, Baudelaire, Balzac… Je ne crois pas que je vivais sous Louis XIV, ni dans le Paris du XIXème siècle, encore moins en Touraine. Cet éloignement, ce grand voyage que notre professeur nous proposait, nous plongeait dans un bonheur extatique. Il nous transmettait, nous faisait sentir des choses très éloignées de nos quotidiens.
À ce titre je me considère comme un héritier de la culture Française, héritage au sens que lui donnait Charles Péguy. D’où qu’on vienne, on avait accès à cet héritage, à quinze siècles d’histoire, au mélange subtil de Homère et la Bible. Je fus étonné de voir la grande défiance de certains à l’endroit de cet héritage vu comme encombrant et anachronique. Votre livre m’a réconforté, m’a réconcilié avec l’idée que je me faisais de la culture Française, de sa transmission. Grâce à vous je pourrai dire comme Sartre que « je suis Français par la langue ».
La transmission de cet héritage, dont j’ai bénéficié, devrait être l’urgence nationale, bien avant les préoccupations économiques passagères. Que ne fut pas mon grand étonnement d’entendre de jeunes gens nés en France me reprocher de « faire mon français » alors que je ne le suis pas. Ah ! mon professeur de français croyait, le « suranné », qu’en nous faisant lire Le Cid, on ne nous obligeait pas à renier pas ce que nous sommes, mais qu’on nous permettait de goûter à ce que l’humanité a de meilleur. Bien loin des « valeurs de la République », on apprenait ce qu’est la France avant tout, c’est-à dire un pays littéraire qui a nourri avec sa langue un rapport charnel. Mon père, qui n’avait jamais été à l’école et avait connu la colonisation, n’écoutait qu’une seule radio, Radio France Internationale. Non par rejet de ce qu’il est, mais parce que disait-il, « la culture française nous est commune ; et la transmission du savoir est le devoir de toute civilisation ».
L’arrogance de l’époque veut qu’on rompe avec le passé. Voilà une chose curieuse : qu’est-ce que l’instruction, sinon l’enseignement du passé ? En tout cas, c’est ce que nous disait notre professeur de français : « la langue française est un trésor que chacun peut s’approprier, et avec elle la culture française. »
À quinze ans, ce même professeur de français m’offrait L’étranger de Camus. Camus écrit ses plus belles pages, dans Le premier homme, sur son professeur, Monsieur Germain. Camus parle de lui comme un enseignant d’exotisme. Je peux dire que cet héritage lointain m’a également nourri. Votre livre est le plus bel hommage au monde qui nous a précédé, et à tous les « Monsieur Germain » de la terre, dont mon professeur de Français. Je vous en sais gré infiniment. »

Albert Camus. Après avoir reçu le Prix Nobel de littérature, il le dédie à son ancien instituteur. Il écrira de lui, dans Le premier homme :
« Dans la classe de M. Germain, l’école nourrissait chez les élèves une faim plus essentielle encore à l’enfant qu’à l’homme, et qui est la faim de la découverte. (…) Dans la classe de M. Germain, pour la première fois, ils sentaient qu’ils existaient, et qu’ils étaient l’objet de la plus haute considération : on les jugeait dignes de découvrir le monde. »