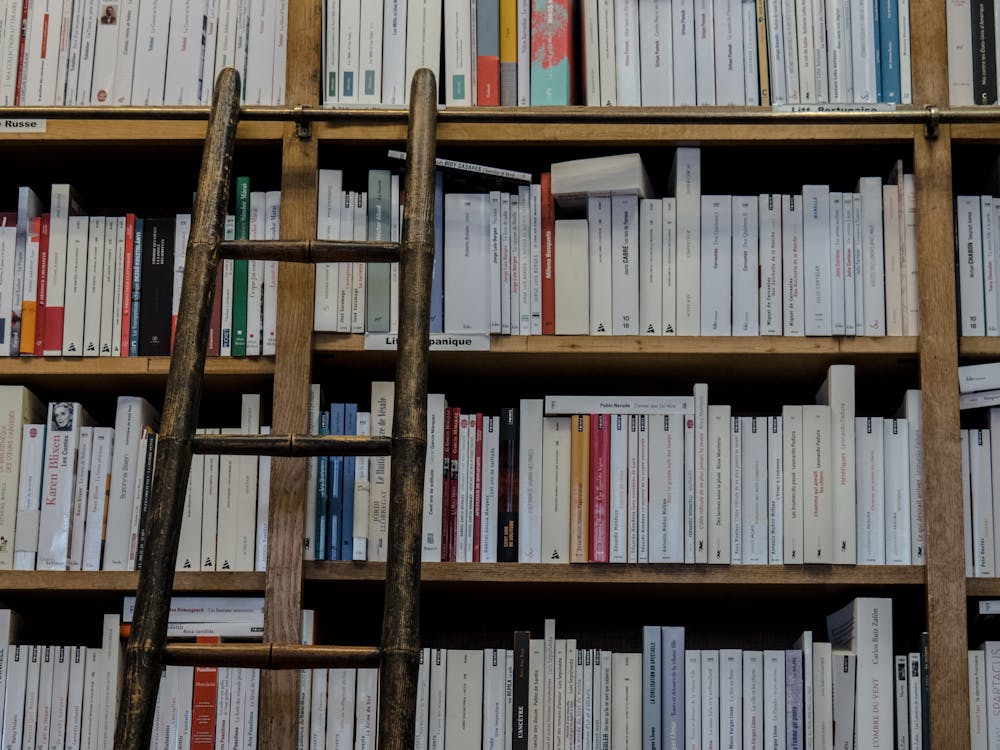La France doit dire ce qu’elle est
Entretien initialement paru dans L’Incorrect du mois de mars 2021.
Le projet de loi actuellement en discussion devait porter sur l’islamisme. Il prétend maintenant veiller au « respect des principes de la République » par toutes les religions, de peur de « stigmatiser » l’islam. Qu’en pensez-vous ?
Ce projet de loi est totalement décalé par rapport à l’enjeu. J’ai du mal à comprendre l’erreur de diagnostic et de solutions. Il y a une erreur de fond dans le fait de croire que le problème serait lié aux religions : le sujet, c’est la rencontre à haut risque de de l’islam avec la culture française et la civilisation européenne. De ce point de vue, la réponse ne peut d’ailleurs pas se trouver contenue dans une simple loi.
Le problème fondamental est intellectuel, spirituel, civilisationnel. Il consiste à savoir si nous voulons encore défendre, préserver et transmettre notre héritage. Cet héritage inclut une certaine manière de vivre, de voir le monde, une certaine conception de la relation entre l’homme et la femme, une certaine idée de la raison, une certaine organisation politique, et en elle l’idée de la laïcité, qui est en réalité une idée européenne, parce qu’elle est une idée chrétienne — le mot même de laïcité vient de la théologie chrétienne.
Vouloir s’en prendre de manière équivalente à toutes les religions, ou vouloir revenir aux débats internes à l’esprit européen quand il s’agissait de limiter l’emprise de la religion sur le pouvoir temporel, c’est commettre une erreur majeure. Aujourd’hui, le sujet n’est plus la distinction entre le temporel et le spirituel dans un monde chrétien ; c’est la préservation du modèle hérité de la tradition judéo-chrétienne face à la montée de la culture musulmane, elle-même liée à l’immigration massive. Il peut y avoir une évolution de la loi pour améliorer notre réponse sécuritaire ou judiciaire à court terme ; mais le point central, c’est de savoir comment nous serons capables de transmettre de nouveau la France à tous ceux qui grandissent dans notre pays, et dont beaucoup ne se reconnaissent pas de cet héritage.
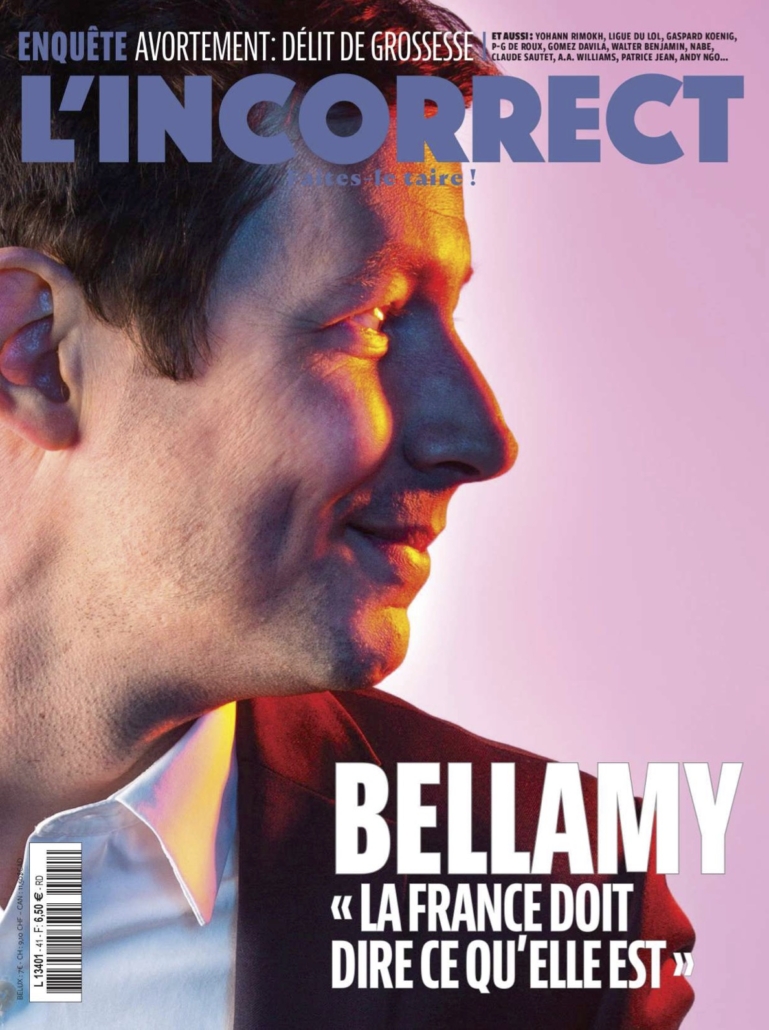
Ne pourrait-on pas imaginer quelque chose sur le modèle de la convocation du Grand Sanhédrin par Napoléon en 1806 ?
L’État ne réformera pas l’islam. L’État n’organisera pas l’islam. Projeter cela, ce serait se méprendre sur la nature de cette religion, qui ne connaît pas une structuration semblable à celle de l’Eglise par exemple. Par ailleurs, il y aurait un abus de pouvoir dans l’idée que l’on va intervenir de l’extérieur dans le culte musulman : nous n’avons pas à dire ce qu’un musulman a le droit de croire ou de ne pas croire, ce qu’il doit penser ou ne pas penser. Sans compter que cet abus de pouvoir ne fonctionnera pas. Je l’ai vécu comme prof et comme élu local : la montée de la radicalité chez beaucoup de jeunes musulmans fait que les responsables qui s’accordent avec les institutions se trouvent de facto discrédités. Une immense majorité des croyants refuseront logiquement d’adhérer à des dogmes négociés avec l’Etat… Nous n’avons rien à gagner à entrer dans cette logique.
Ce serait aussi décalé que, par exemple, de vouloir proscrire la kippa dans l’espace public, comme le propose depuis longtemps Marine Le Pen. Il y a depuis quinze ans une montée de la pression islamiste dont les Français de confession juive sont directement les victimes, et à la fin, quand il faut y répondre, on dit : qu’ils enlèvent leur kippa ! C’est absurde !
Alors que doit-on faire ?
La seule chose que doit faire la France, c’est de dire ce qu’elle est et ce qu’elle ne négociera jamais. À partir de là, à chacun de juger s’il veut vivre dans notre pays. Oui, la France est le pays de la liberté de conscience, donc en France on a le droit d’être musulman – c’est une grande chance parce que dans les pays musulmans, on n’a pas toujours le droit d’être chrétien… Cela implique que la France est un pays où la parole est libre, avec les excès que cela peut entraîner. En France, il peut vous arriver de croiser une caricature qui heurte votre foi – je le dis comme un catholique à qui il est arrivé de se sentir parfois blessé par une caricature –, mais c‘est comme ça, c’est la France. À ceux qui trouvent ça trop pénible, à ceux qui sont trop fragiles pour le supporter, je dis qu’il y a des tas de pays dans lesquels ils seront sûrs de ne jamais voir une caricature du prophète, et qu’ils peuvent parfaitement choisir d’y vivre. Je ne peux le leur reprocher : choisissez un autre pays, une autre manière de vivre, et restons bons amis ! Mais si vous voulez vivre en France, vous devez épouser ce modèle.
Vous pensez qu’une majorité de jeunes musulmans est prête à l’accepter ?
Dans notre histoire, beaucoup de musulmans sont morts pour la France ; il n’y a aucune raison pour qu’un citoyen musulman se sente étranger à la France. Je crois profondément que beaucoup de jeunes issus de l’immigration sont prêts à estimer un pays qui s’estimerait lui-même. C’est pour cela que le vrai sujet est politique, au sens le plus fort du terme – non pas seulement sécuritaire, ou institutionnel… Au fond, il renvoie notre pays à sa propre incapacité à s’assumer et à se transmettre. Quand on élit un président de la République qui nous a dit qu’il n’y avait pas de culture française, il est évident que ça ne peut pas marcher. Vous ne pouvez pas intégrer et vous ne pouvez pas assimiler si vous partez du principe que votre pays n’a rien à proposer, qu’il n’a pas une culture à recevoir et à rejoindre.
L’islamisme des cités est d’ailleurs un adversaire idéologique d’une fragilité insigne. Il faut bien avoir conscience que la médiocrité et la superficialité de son discours ne se propagent qu’à proportion du vide que nous laissons derrière nous, quand nous refusons d’assumer ce que nous sommes et de le transmettre.
Vous dites : « On ne peut pas intégrer, on ne peut pas assimiler. » Ce n’est pas la même chose. Vous souhaitez intégrer ou assimiler ?
J’assume parfaitement l’idée de l’assimilation, un projet d’une immense générosité et qui est particulièrement français, parce que la France a toujours eu une relation particulière avec l’universel. La singularité paradoxale de la France est d’avoir toujours cru qu’elle pouvait s’adresser à tous. Le projet de l’assimilation est très français en ce sens qu’il signifie que d’où que vous veniez, quelle que soit votre histoire personnelle, si vous habitez en France, et a fortiori si vous souhaitez partager la nationalité française, vous pouvez être pleinement participant de cette histoire qui se prolonge à travers nous tous. On a fait de l’assimilation une sorte de tabou : Emmanuel Macron a récemment expliqué, dans l’Express, qu’il fallait supprimer du code civil la nécessité de “justifier de son assimilation à la communauté française” pour pouvoir être naturalisé. En réalité, comme l’a récemment montré Raphaël Doan, l’assimilation est l’exigence la plus antiraciste qui soit. Elle consiste à dire : vous n’avez pas besoin d’avoir les gênes d’une ethnie particulière pour être assimilé à la communauté de destin qui s’appelle la France. Évidemment, aujourd’hui, réussir le défi de l’assimilation suppose un préalable : mettre fin, de manière urgente, aux flux migratoires massifs qui rendent impossible la reconstitution de l’unité de la nation. Mais je crois malgré tout que le projet de l’assimilation, que la France a réussi dans son passé, comme le montrent ces Français qui le sont devenus “non par le sang reçu mais par le sang versé”, est plus nécessaire que jamais. On n’échappera pas à l’« archipellisation » de la France sans renouer avec ce projet.
Pour paraphraser de Gaulle, on peut assimiler des individus : pensez-vous que l’on puisse assimiler des peuples, et n’est-il pas déjà trop tard ? Et vous parlez de stopper les flux migratoires : est-ce qu’il faut simplement les stopper ou est-ce qu’il faut les inverser ?
Pour la première question, oui, on se demande s’il n’est pas déjà trop tard. Je l’assume sans difficulté. Cela étant dit, j’ai trente-cinq ans, je ne compte pas baisser les bras. Comme le dit Marc Aurèle : « Les batailles que je n’ai pas livrées, je me console trop facilement dans la certitude qu’elles étaient déjà perdues ». Je ne veux pas me résigner à la fracturation de la France dans une juxtaposition de communautés qui ne se connaissent plus de lien. Il me semble que la puissance de notre héritage peut encore susciter l’enthousiasme et l’adhésion.
J’ai enseigné dans des zones urbaines sensibles où il y avait 90% ou 95% de jeunes issus de l’immigration. Je n’ai jamais eu un élève qui m’ait dit : « Je ne veux pas de votre philosophie ethnocentriste, occidentale et néocoloniale ». Ça, c’étaient mes formateurs à l’IUFM qui me le disaient ! Mes élèves, quand je leur parlais de Platon et d’Aristote, étaient capables de s’y reconnaître. Quand vous arrivez devant des jeunes gens en leur disant que vous avez quelque chose à leur offrir qui vaut la peine d’être reçu, vous retrouvez en eux la soif infinie d’apprendre, et de rejoindre quelque chose de plus grand que nous qui mérite d’être partagé. Je ne nie pas qu’il y a une sorte de pari. Je ne suis pas optimiste de nature, mais je ne peux pas me résigner. Et je crois qu’il y a dans l’identité française quelque chose d’assez grand pour pouvoir surmonter la crise existentielle que nous traversons.
Pour réussir ce défi, et c’est votre deuxième question, commençons par mettre un terme aux flux migratoires qui continuent. Rappelons quand même que depuis quarante ans, on n’a jamais délivré autant de titres de séjour que depuis 2017. Je ne cesse de l’expliquer à bien des gens qui affirment qu’Emmanuel Macron mène une politique de droite. En 2019, c’est l’équivalent de la ville de Nantes qui s’est installé légalement en France, essentiellement d’ailleurs en provenance des pays du Maghreb et de la Turquie. Et je ne parle même pas de l’immigration illégale… C’est évidemment intenable.
Lorsque la région Île-de-France, durant le premier confinement, a mis en place un outil pour apprendre une langue étrangère en ligne, elle a eu la surprise de voir que la première langue demandée était le français, et de loin ! On ne peut pas continuer à accueillir quand on vit un tel échec de l’assimilation.
Votre famille politique, notamment sous le mandat de Nicolas Sarkozy, a accueilli elle aussi beaucoup de gens. Il y a même eu une explosion du nombre d’entrées. Il y a une prise de conscience au sein de LR ?
Je ne me suis pas engagé en politique parce que tout allait bien, et je ne me suis pas engagé à droite parce que la droite avait tout réussi. Je me suis engagé justement parce que je crois qu’il est nécessaire que cette prise de conscience puisse avoir lieu à l’intérieur de la droite. La grande fragilité de la droite aujourd’hui, sa fragilité politique et électorale, vient de la profonde déception de beaucoup d’électeurs qui lui reprochent de ne pas avoir tenu ses promesses. Pendant toute la campagne des élections européennes, j’ai entendu des gens me dire : « Ce que vous dites est très bien, mais on ne se fera pas avoir une nouvelle fois ». Il y a une corrélation très claire entre le fait que la droite, lorsqu’elle était au pouvoir, n’a pas été à la hauteur des engagements qu’elle avait pris, et le discrédit qu’elle subit aujourd’hui. Cela étant dit, on ne peut pas être complètement relativiste : en matière d’immigration par exemple, la politique menée n’a pas été la même sous la droite que sous la gauche ; et Emmanuel Macron va plus loin que la gauche, en termes d’entrées légales sur le territoire national.
Y a-t-il un consensus sur ce sujet au sein de LR ? On sait à peu près ce que pense chacune de ses personnalités, mais concernant la ligne du parti, c’est nettement plus flou…
Sur les questions migratoires, la ligne de notre famille politique est parfaitement claire. Nous l’avons exposée lors des élections européennes : nous pensons qu’il faut une stratégie globale, à la fois européenne et nationale. C’est ce que nous avons appelé la« double frontière ». Je suis allé sur l’île de Lesbos, pour voir le gigantesque camp de migrants qui s’y trouve. Vu de ces îles, situées à quelques kilomètres seulement des côtes turques, il est évident que la Grèce ne pourra pas défendre toute seule ses frontières face à la pression migratoire. De plus, les gens qui entrent en Grèce ne veulent pas y rester. Ils veulent se rendre en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne : il est donc nécessaire et légitime que nous soyons aux côtés des pays de première entrée, en renforçant Frontex notamment, pour maîtriser ensemble les frontières extérieures de l’Europe. Jusque-là, ça n’a pas été fait, c’est sur cette priorité que nous travaillons. Au Parlement européen, nous sommes engagés dans une bataille politique rude pour défendre une doctrine d’emploi assumée pour Frontex : une agence de garde-frontières n’est pas là pour accueillir les gens qui entrent illégalement, mais pour les refouler. Ce travail commun est indispensable : il est vain de prétendre que l’on maîtrisera nos frontières face à la pression migratoire si les pays européens n’y travaillent pas ensemble. La position du RN sur ce sujet, qui a sans cesse voté contre tout renforcement de Frontex, est purement idéologique et me semble irresponsable. Si demain la Grèce est envahie, ça ne peut pas ne pas avoir de conséquences sur nous. Il faut donc agir ensemble, pour permettre que chaque pays garde la maîtrise de sa politique migratoire. C’est parce que nous tenons à garder à chaque Etat sa souveraineté en la matière que nous parlons de « double frontière ».
Le parti européen au sein duquel vous siégez, le Parti populaire européen (PPE), est-il en phase avec ça ? Il ne nous a pas donné l’impression de vouloir « refouler » les migrants.
Durant le précédent mandat, et particulièrement lorsque l’Allemagne a ouvert grand les frontières à l’été 2015, le PPE s’est littéralement fracturé sur la question migratoire. Deux lignes complètement opposées s’y sont affrontées : d’un côté il y avait celle d’Angela Merkel, de l’autre celle de Viktor Orbán. Or cinq ans et demi plus tard, que constate-t-on ? Que sur le fond, tout le groupe s’est rallié à la position de Viktor Orbán ! Aujourd’hui, plus personne dans le PPE ne défend l’idée d’un accueil inconditionnel des migrants. Angela Merkel elle-même ne referait plus ce qu’elle a fait en 2015… Même au-delà du PPE, les États européens se sont ralliés à la ligne de protection des frontières défendue par le Premier ministre hongrois. Ce qui est tout à fait paradoxal car Viktor Orban continue à être victime d’une forme de procès permanent, alors même que sur les questions migratoires, tout le monde parle désormais comme lui.
Concrètement, la doctrine qui prévalait jusque-là, et qui était d’ailleurs soutenue par Emmanuel Macron, était celle dite de la « relocalisation » des migrants : des gens entrent dans l’UE de façon illégale, au nom de la “solidarité” entre pays européens, on se les répartit et on oblige chaque Etat-membre à accepter son quota de migrants. C’était cela que Viktor Orbán refusait. Or la Commission européenne vient de présenter son nouveau “pacte migratoire”, et le point majeur est qu’elle renonce à la relocalisation des migrants. La solidarité européenne face à la question migratoire voudra dire que les Etats devront, selon leur choix, à à contribuer à la maîtrise des frontières ou aux reconduites hors de l’Europe des migrants illégaux C’est un changement complet de paradigme. La gauche est ulcérée, et il faut la comprendre : dans ce débat, Viktor Orbán a gagné !
Il y a encore beaucoup de travail, bien sûr, mais le débat progresse enfin. J’ai été chargé par le groupe du PPE d’écrire un texte sur l’identité de la droite en Europe : le passage sur l’immigration, qui fixe pour priorité la maîtrise de nos frontières, a été adopté par le groupe dans son ensemble après un travail d’amendements. Aujourd’hui, je pense que les choses peuvent être réorientées dans le bon sens. Avec certes toutes les pesanteurs de ces institutions – ça prend du temps, c’est lent, c’est compliqué… – mais globalement, dans la matrice européenne, quasiment plus personne ne dit, à l’exception de la Commissaire européenne aux Affaires intérieures, la social-démocrate suédoise Ylva Johansson, que les migrants sont une chance pour nos usines et pour compenser la baisse de la natalité de l’Europe…
En 2018 sur France Culture, lors d’une émission d’Alain Finkielkraut et alors que vous n’aviez pas encore été désigné tête de liste aux élections européennes mais que le JDD venait de faire état de cette probabilité, Sylvain Tesson vous avait imploré de « ne pas rentrer dans ce débat qui risque lui-même d’être un mouvement qui vous perdra ». Vous ne regrettez pas de ne pas l’avoir écouté ?
C’est une bonne question. Je ne suis pas entré en politique parce que ça m’amusait. C’est une expérience passionnante et je ne me plains pas de ce que je vis, mais si j’avais eu le sentiment que la France allait bien, je serais resté prof de philo. J’ai adoré mon métier, c’était ma vocation professionnelle, il reste mon élément naturel et j’espère le retrouver. Je suis entré en politique parce que tout ce à quoi je tiens est menacé. Je n’étais pas adhérent des Républicains, mais je me suis toujours senti de droite ; cette famille politique est venue me chercher : si j’avais décliné, je me serais senti illégitime de continuer à écrire des livres pour expliquer ce qui ne va pas.
La politique est un combat. Si vous croyez au sérieux de ce qui s’y joue, vous ne pouvez pas demeurer spectateur, ni même commentateur. Il faut entrer sur le champ de bataille.
Et vous pensez que de LR peut sortir un candidat qui ne fasse pas simplement de la figuration ?
Je crois que la droite a la responsabilité d’incarner une alternative, parce que le Rassemblement national fait objectivement partie de l’équation qui sauve Emmanuel Macron – je dis cela sans aucun jugement moral, ne détestant rien tant que tous ceux qui transforment les désaccords politiques en condamnations condescendantes. Je sais que la politique suppose des discernements difficiles dans le clair-obscur du réel, comme l’expliquait Aristote..Mais c’est un fait que la seule chose que redoute Emmanuel Macron, ce serait une droite enfin sortie de sa torpeur. Lors de l’élection européenne, j’ai espéré commencer une alternative, et nous n’y sommes pas arrivés. Notamment parce que dix jours avant le scrutin, Emmanuel Macron a brandi le risque de voir la liste du RN triompher, que Marine Le Pen lui a répondu, ce qui est normal, et que les médias se sont focalisés sur ce duel en forme de tandem. Pendant dix jours, les Français ont suivi à la télévision le troisième tour de l’élection présidentielle, et ils se sont prononcés par rapport à cette mise en scène. La politique, c’est aussi ça. On a eu beau faire une belle campagne, en tout cas une campagne que je ne renie pas sur la forme ni sur le fond, la construction de l’opinion passe encore par les journaux télévisés, qui nous ont largement ignorés.
Durant toute cette campagne, Emmanuel Macron n’a eu qu’une obsession : éviter que la droite ne se reconstruise à l’occasion de ce scrutin. Il y est parvenu. Nathalie Loiseau a refusé tous les débats que les médias lui proposaient avec moi. Et elle n’a accepté de discuter qu’avec Jordan Bardella. Il suffit de bien vouloir ouvrir les yeux pour voir que le macronisme a besoin du RN, qui pour bien des raisons reste très éloigné d’une victoire à l’élection présidentielle – bien des gens autour de Marine Le Pen le savent parfaitement, d’ailleurs… Le parti au pouvoir n’aurait aucune chance de s’y maintenir si nous étions dans une configuration politique normale. C’est la raison pour laquelle la vraie inquiétude pour Emmanuel Macron, c’était qu’un nouvel élan reprenne à droite et que les électeurs se remettent à y croire.
Parmi les faiblesses de la droite, ne pensez-vous qu’il lui manque d’avoir une ligne claire sur l’écologie ? Elle est globalement considérée comme libérale, donc comme anti-écologiste.
La droite s’est occupée d’écologie quand elle était au pouvoir et qu’on en parlait infiniment moins que maintenant, mais il est vrai qu’elle n’a pas de discours construit sur les sujets écologiques. Le travail à faire est d’autant plus important qu’il est urgent de proposer une écologie qui ne porte pas atteinte à nos libertés fondamentales.
Je suis inquiet quand j’entends Barbara Pompili nous dire que ce qui compte maintenant, ce n’est pas de changer notre manière de consommer, mais de changer notre manière de vivre et même, de changer notre civilisation ! Là, il y a une véritable idéologie, qui se préoccupe d’ailleurs assez peu de l’environnement – je le vois au Parlement par exemple sur le sujet de l’éolien, à terre ou en mer, qui est défendu par ces militants malgré son impact écologique désastreux. . Cette écologie a simplement trouvé une occasion de recycler un vieux fonds totalitaire hérité du marxisme et de l’antilibéralisme de gauche. Si la politique est faite pour sauver ce qui doit l’être, et je crois que c’est ce qui définit la droite, cela suppose évidemment de se préoccuper de transmettre, à la fois notre culture, et une nature qui permette que le monde reste vivable. C’est à cette cohérence qu’il faut travailler.
Vous voulez sauver et transmettre ce qui doit l’être, et, « en même temps », vous avez parlé d’« épuisement du modèle dont nous héritons ». Qu’est-ce qui reste à sauver ? Est-ce qu’on n’en est pas au stade de la décadence de l’Empire romain ?
Vous posez la question la plus difficile qui soit, savoir si la politique peut quelque chose à une forme de crise intérieure. Au fond, est-ce que la politique peut sauver un pays si ce pays ne veut plus se sauver lui-même – si ce pays a perdu le goût de continuer à exister ? Je dirais qu’on n’a pas le droit de se résigner. Aujourd’hui, comme dans certaines périodes de l’histoire, le levier de l’engagement politique pourrait être : « Et si jamais… » Et si jamais il y a une chance, même infime, que la France retrouve le goût d’exister, alors cette chance vaut la peine qu’on engage sa vie là-dessus.
J’imagine que quand Hans et Sophie Scholl ont créé La Rose blanche, en 1942, ils ne devaient pas avoir beaucoup d’espoir que la situation s’améliore. Et pourtant ! J’ai été profondément bouleversé par le dernier film de Terrence Malick, Une vie cachée, sur ce paysan autrichien, Franz Jägerstätter, qui avait refusé de prêter le serment de loyauté à Hitler. D’une certaine manière, ça ne servait à rien, la partie était perdue. Jägerstätter a donné sa vie sans voir la victoire à laquelle il espérait pourtant contribuer de manière presque infime. Et pourtant, ça valait la peine. Même si nous ne sommes pas dans une situation aussi dramatique, la question se pose de savoir si l’on peut quelque chose à un processus qui donne le sentiment d’être intérieur et donc irréversible, en tout cas par des moyens politiques. Mais si jamais il y a encore une chance, elle vaut la peine d’être vécue.
Cette chance, on la tente comment ?
La réponse politique la plus importante, qui devrait être la seule et unique priorité de la droite si elle parvenait à retrouver la confiance des Français, c’est l’éducation. Tout se joue dans l’éducation, tout, et il y a urgence. Un pays qui n’a pas transmis sa culture est un pays qui se perd de manière définitive. Beaucoup d’erreurs politiques sont rattrapables : vous pouvez avoir été laxiste en matière de sécurité avant de vous rendre compte que c’est devenu le désordre et de remettre des policiers dans les rues ; vous pouvez avoir été trop dépensier et avoir accumulé de la dette, et un jour décider qu’il faut remettre les finances d’équerre. Mais si vous manquez la transmission de la culture, alors où trouverez-vous ceux qui, demain, deviendront les professeurs qui l’enseigneront à nouveau ?
C’est pour cela qu’il y a une urgence éducative absolue. C’est quasiment le seul sujet politique dont on devrait s’occuper, parce que si on ne se transmet plus, nous perdrons jusqu’à la conscience des trésors qui se seront dissipés. Ceux qui n’auront pas reçu notre culture ne pourront même pas mesurer la valeur de ce qu’ils auront perdu.
Face à la situation sanitaire, les Français demandent semble-t-il toujours plus de sécurité et de restriction de leurs libertés.
Ce qui m’inquiète profondément, c’est le risque de ne plus sortir de la situation que nous vivons aujourd’hui. Emmanuel Macron disait récemment que le principe de la réponse sanitaire est que rien n’est plus important que de sauver une vie humaine. En un sens, je partage son point de vue : la vie humaine a une valeur absolue et ce principe mériterait d’être rappelé sur le terrain des questions de bioéthique… Le problème de cette affirmation, c’est que si elle est valable éthiquement dans l’appréciation que l’on fait de l’action de chaque personne, elle ne peut pas servir de fondement à une conception politique. Sinon, il faut tout de suite interdire la circulation en voiture, parce qu’il y a des accidents de la route et que certains sont mortels. Et même, il est impératif de confiner les gens de façon définitive parce que c‘est le plus sûr moyen qu’il ne leur arrive rien en marchant dans la rue ou en rencontrant d’autres personnes…
Encore que les accidents domestiques sont une cause importante de mortalité…
[rires] On voit bien que la société du risque zéro est une société invivable. Si notre seul et unique objectif est d’éviter la mort, alors nous n’arriverons qu’à empêcher la vie. C’est la vie que nous perdons en la construisant seulement pour éviter de mourir. C’est exactement le monde auquel il faut tenter d’échapper. De ce point de vue, il y a un problème majeur dans notre rapport à la liberté. C’est pourquoi je crois que notre famille politique doit embrasser de nouveau la cause de la liberté. Je suis très inquiet de voir que parce que nous nous élevons,, à raison, contre la folie de la mondialisation néolibérale, certains en viennent à jeter la liberté avec l’eau du bain néolibéral. Rien n’est plus nécessaire que de défendre la cause de la liberté.
Lors d’un débat au Parlement européen sur les applications de traçage, je me suis opposé à celles-ci, au nom de la liberté. J’étais quasiment le seul dans ce cas. Dans le débat qui nous a opposés, un de mes collègues parlementaires a dit littéralement : « Je préfère vivre encadré plutôt que mourir libre ». La formule est incroyable ! Je lui ai répondu: « Je te conseille d’aller faire un tour sur le plateau des Glières. » « Vivre libre ou mourir », c’est ce qui a structuré notre civilisation.
Dans Zarathoustra, Nietzsche écrit : « Formule de mon bonheur : un oui, un non, une ligne droite, un but. » Bellamy, quel but ?
Cette formule est magnifique. Je l’ai souvent citée à mes étudiants…
Si un seul mot pouvait définir l’engagement, ce serait sans aucun doute servir. Je pense que ce qui compte le plus dans une existence, c’est qu’elle puisse être engagée au service de quelque chose de plus grand qu’elle. Je me sentirais heureux si, la veille de ma mort, je pouvais me dire que j’ai pu servir à quelque chose de plus grand que moi. Et, en particulier, que j’aie pu servir à la transmission de cet héritage qui a fait de moi ce que je suis, auquel je dois tout, et qui, j’en suis sûr, peut encore être une promesse de vie et de liberté pour d’autres que moi à l’avenir.